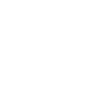
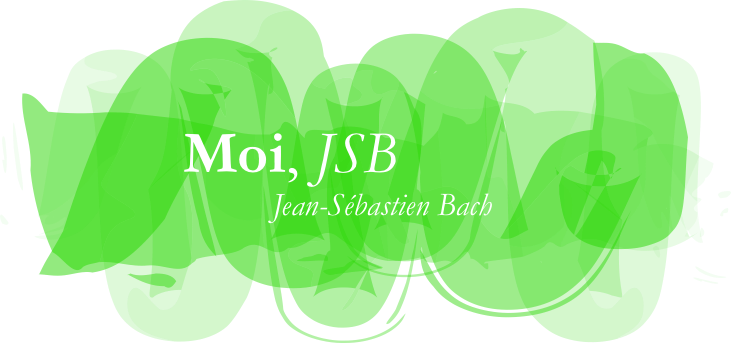
Leipzig - Berlin (1739-1749)
Je crois que jamais, de ma vie, je n’avais été aussi occupé qu’en cette année 1739: il y avait mes nouveaux élèves, les commandes de musiques de fêtes, les déplacements pour aller expertiser des orgues, le projet pour l’orgue de Saint Thomas, mon regain d’intérêt pour la fabrication d’instruments, les concerts, les réceptions d’amis. Devant toutes ces tâches, j’avais été amené à réduire mes activités de cantor. L’attitude d’Ernesti y était pour beaucoup. Bien sûr, je dirigeais les dimanches et fêtes des œuvres déjà écrites par moi ou d’autres. Mais je me faisais remplacer de plus en plus pour l’enseignement de la musique aux jeunes débutants et bientôt on nomma quelqu’un pour ce travail. Les autorités en place à Leipzig semblaient tolérer tout cela: d’ailleurs si elles ne le toléraient pas, je les envoyais au diable. Toujours cette histoire de vieux couple : presque 20 ans de vie commune, maintenant entre Leipzig et moi !
Je me souviens en particulier d’une scène parmi d’autres. C’était à Pâques 1739 : j’avais choisi de jouer une passion que j’avais déjà dirigée plusieurs fois. Mais ces messieurs avaient décidé de m’agacer et il y réussirent fort bien. Il m’envoyèrent huit jours avant un sous-greffier, répondant (ça ne s’invente pas) au nom de « Croquemort d’Abeille ». Il sonna. Jean-Elias alla lui ouvrir. J’entendis :
– Est-ce bien ici qu’habite monsieur Bach ?
– Mais oui, bien sûr, voyons.
– J’ai un message du très sage Conseil pour lui.
– Donnez-le moi.
– Non, je dois lui délivrer oralement.
Je criai :
– Fais-le monter !
Le jeune sous-greffier monta lentement, s’arrêta devant la porte, il était vêtu tout de noir :
– Entrez donc, jeune homme.
Il avait un papier à la main
– Monsieur Bach…
– Oui, ah mais nous nous connaissons je crois, dis-je sans lever la tête.
– Le très sage Conseil…
– Qu’est-ce qu’il me veut, le très sage Conseil ?
– Le très sage Conseil…
– Vous l’avez déjà dit.
– Me charge de vous dire…
– Quoi ? allons vite, mon garçon : vous voyez bien que je suis fort occupé. Je travaille pour ceux qui vous envoient : je mets la dernière main à la Passion de la semaine prochaine…
– C’est-à-dire que justement…
– Qu’y a t’il encore ? Allons lisez-moi votre papier, dis-je en levant enfin la tête vers lui.
Le jeune homme en noir lut d’un trait :
– La musique que vous avez prévue pour le prochain vendredi saint ne devra pas avoir lieu tant que vous n’aurez pas reçu l’autorisation ordinaire.
Puis il baissa les yeux.
– Jeune homme, regardez-moi. Retenez bien ceci et allez le répéter à ceux qui vous envoient, mot à mot, vous m’entendez mot à mot : c’est votre métier de répéter. Dites-leur ceci : « C’est à chaque fois la même chose: on m’interdit. Je ne demanderai aucune autorisation, d’ailleurs cette autorisation, je n’en ai rien à… faire, ce ne sont que des simagrées. Je vais rendre compte au surintendant de cette interdiction". Attendez, dites leur aussi ceci: "Si c’est en pensant aux textes que cela est fait, ces textes ont déjà été chantés plusieurs fois". Dites-leur bien cela. Maintenant laissez-moi travailler et allez au diable.
Le jeune homme restait là, figé.
– Allez ouste, jeune homme, vous avez entendu ? Je travaille, moi et quand je dis quelque chose, je sais de quoi je parle.
Le jeune sous-greffier descendit l’escalier beaucoup plus vite qu’il ne l’avait monté.
Restait l’essentiel, qui d’ailleurs pourrait contribuer à combler les insuffisances désormais flagrantes du chœur de l’école: Ernesti en était un des grands responsables. L’essentiel, c’était mon grand projet de musique pour orgue, ce que j’appelais le troisième cahier d’exercice. Je voulais le terminer pour Pâques mais je ne fus pas prêt : j’avais tant à faire et puis il y avait des problèmes d’imprimerie. Il y avait surtout ma volonté de construire un édifice musical audacieux dans ses dimensions et dont chaque pièce soit parfaite dans sa forme.
La création de cette œuvre m’aida à supporter deux nouvelles bien pénibles pour moi. La première fut l’annonce de la mort de mon cher Jean-Ernest, le fils de la Tante Marthe et du frère jumeau de mon père. Avec lui j’avais partagé une partie de mon enfance à Arnstadt, puis au lycée d’Ohrdruf, puis à Hambourg et il m’avait remplacé à Arnstadt. Grâce à lui j’avais connu le grand Buxtehude. Il paraît qu’il était mort aveugle. La seconde nouvelle pénible fut la disparition sans espoir de retour de notre cher fils Bernard : je priai Dieu pour qu’il le prenne en son sein quand il paraitrait devant lui.
Quand Guillaume vint en Juillet 1739 avec des amis musiciens, la plus grande partie du troisième cahier était terminée. Je le lui montrai :
– Père, la dernière fois que tu m’as montré une œuvre, c’était devant Keyserlingk, le concerto italien, si gai, si profane. Et maintenant, ce monument religieux !
– J’ai peur pour notre religion, mon fils !
– Tu sais, ce n’est pas parce que la Raison…
– Oui, je sais, mais ta Raison ne peut expliquer tous ces symboles religieux qui sont autant de marches et d’indications que Dieu nous révèle dans les livres Saints et que les écrits de Luther nous font si bien comprendre.
– Écoute, regarde, père, dis-toi que les mathématiques ne sont que des symboles eux aussi. Leibniz parle aussi bien des miroirs que du calcul infinitésimal.
– J’ai beaucoup réfléchi à ce fameux calcul infinitésimal. C’est un peu comme si, au bout de l’infini, nous trouvions une nouvel ordre : Dieu par exemple ?
– On peut le comprendre comme ça, oui pourquoi pas ? Les mathématiques, comme la religion expliquent l’inexplicable.
– Si tu mets face à face deux miroirs, tu as aussi des reflets à l’infini, c’est ce que nous faisons en musique avec des canons et les fugues qui peuvent être en miroir, en mouvement contraire, renversé, rétrograde, composé, circulaires, en augmentation, en diminution et même perpétuels
– Tu oublies ceux qui sont « à l’écrevisse ».
– Non je n’oublie pas… mais cela sonne mal à l’oreille... Oui, mon fils, tu as raison, tous ces mécanismes, comme ceux des mathématiques sont pleins de mystère…
Je restai silencieux un instant.
– Tiens à propos de mécanisme, je voudrais te montrer mon nouveau clavicorde regarde…
Je lui montrai une modification que j’avais bricolée moi-même avec quelques outils et qui permettait d’améliorer la sonorité de mon clavier-luth.
– Tu vois je peux jouer piano ou forte selon les passages de ce prélude. Il suffit de glisser cette petite barrette près des cordes. Écoute…
– Et je lui jouai un prélude.
– Mais père, tu es un vrai professionnel, tu pourrais inventer et fabriquer des instruments toi-même comme certains de nos cousins.
– Le temps me manque, mon fils.
Quand Guillaume repartait, quelque chose de moi s’en allait avec lui.
Je marchai chaque jour beaucoup pour aller d’un point de la ville à l’autre. Parfois je regardai tout autour de moi les gens, les marchands, (tout ce peuple de tailleurs, savetiers, tailleurs de pierre, charpentiers, cuisiniers, sommeliers comme disait Luther) les libraires, les enfants, les paysans, les bourgeois, les ouvriers, les notables. Certains marchaient comme moi en silence, d’autres criaient, couraient, s’affairaient, chantaient parfois, d’autres encore circulaient à cheval ou dans des carrosses, malgré l’étroitesse des rues.
Mais il m’arrivait aussi d’être si absorbé que je ne me rendais plus compte de ce qui ce passait autour de moi: mon esprit était immergé dans des musiques. Ce jour-là, je pensai à la conversation que j’avais eue avec mon fils à propos des miroirs, des canons et des mathématiques… Je ressentais plus fort que jamais en moi, cet attrait pour les chiffres et les symboles, qu’ils soient mathématiques ou non. Rappelez-vous, j’éprouvais cela depuis mon adolescence. Mon fils Emmanuel m’en avait même parfois fait le reproche. Cela venait du fonds de moi-même et de la foi que m’avait transmise mes ancêtres. Jamais des hommes au prétendu grand savoir comme Ernesti, Wolff et leurs comparses ne pourraient donner par tous leurs commentaires ne serait-ce qu’un début d’explication à la profondeur des textes et des symboles contenus dans les Écritures Saintes. Seule la musique, au delà des mots, peut tenter de rendre gloire à la suprême perfection, à la suprême complexité, à la suprême humilité, au suprême sacrifice de ce Dieu venu sauver le monde.
Mes réflexions furent brutalement interrompues par des appels venus de l’autre côté de la rue :
– Monsieur Bach, Monsieur Bach !
C’était mon ami Birnbaum qui continuait toujours, inlassablement, à écrire à ma place des textes qui parlaient de moi et de des qualités de ma musique. Il brandissait à la main des gazettes en m’appelant. Il parvint enfin jusqu’à moi:
– Regardez, regardez !
Et tout en marchant, il me montrait des articles. Lui, homme d’habitude si pondéré, je ne l’avais jamais vu dans un tel état ! Nous étions justement dans la rue de Catherine, celle du café Zimmermann.
– Écoutez, cher ami, restez calme, allons au café si vous le voulez bien !
Zimmermann nous accueillit lui-même.
– Alors, monsieur le Cantor, qu’est-ce que vous nous préparez pour vendredi ? Vous savez que tout le monde est content que vous ayez repris vos concerts ici.
Puis s’approchant tout près de moi :
– Vous savez, monsieur Bach, avec Monsieur Gerlach, ce n’était pas la même chose !
– Allons, Zimmermann, allons !
– Qu’est-ce que je vous sers ?
– Pour moi ce sera un petit vin blanc.
– Pour moi, dit Birnbaum, une tasse de café. Bach, tenez, lisez ceci :
Je pris la gazette, c’était le Musicien Critique, la Gazette où Scheibe m’avait tant critiqué :
– Je ne vais pas encore lire ce tas d’immondices.
– Lisez, lisez…
– Ce concerto pour clavier doit être regardé comme le parfait modèle du concerto à une voix. Forcément dès qu’il y a deux voix, il est perdu, ce jeune Scheibe !
– Attendez, ce n’est pas fini ! C’est de votre concerto italien qu’il parle ! "Seul un aussi grand maître de la musique que Monsieur Bach pouvait nous donner une telle œuvre que les étrangers ne pourront chercher à imiter qu’en vain."
- Excessif, ce jeune homme, il change comme une girouette. Quant aux étrangers, bien souvent ce sont nos modèles.
– Allons ne boudez pas votre revanche.
– C’est vrai, Birnbaum, mais il doit y avoir de son ami Mattheson, là-dessous. Celui-là, il voit que je suis célèbre, alors il veut être bien avec moi !
– Vous ne croyez pas si bien dire ! Vous savez qu’il vient de publier une collection de fugues ? Regardez ce qu’il a écrit dans « Le parfait Maître de Chapelle »: "J’aimerais voir quelque chose de cette manière publié par Monsieur Bach de Leipzig, qui est un grand maître de la fugue…"
– Que veut-il dire ?
Je quittai Birnbaum et continuai ma marche et ma réflexion. Tout à coup ma pensée chavira: la suprême perfection n’existe pas. La seule chose que nous pouvons faire, c’est essayer, toujours essayer de nous approcher de la perfection mais en étant sûrs de ne jamais l’attendre. Cela a un nom en mathématiques, Jean-Elias trouvera sûrement cela dans son Leibniz…
Bien sûr, je ferais mieux que Mathesson,. Mais comment ? Depuis ce jour je ne cessai de penser à un nouveau cahier d’exercice qui pourrait tourner autour de toutes les formes du contrepoint et en particulier de la fugue. Contrairement à d’habitude, je ne vis pas tout de suite la tournure que je donnerais à ce travail, mais peu à peu dans mon esprit se construisait une œuvre que personne ne pourrait jamais égaler.
Je rentrai et trouvai Jean-Elias qui, comme chaque soir, m’attendait. Il m’était d’un grand secours : il était devenu presque comme un domestique complaisant et fidèle et me rendait beaucoup de services dans beaucoup de domaines. Nous avions pris l’habitude de travailler le soir, quand toutes nos obligations de la journée avait été remplies. Dois-je l’avouer ? Il ne me déplaisait pas de le taquiner un peu, ce « jeune » universitaire de 33 ans.
– Alors Jean-Elias, qu’as-tu fait aujourd’hui ? Les enfants ?
– Je pense qu’ils sont prêts pour leur communion…
– Bien, et mes fils, qu’ont-ils appris ?
– Votre petit dernier Jean Chrétien est très éveillé pour son âge.
– Sais-tu, Jean-Elias, que moi aussi j’étais le petit dernier ?
– Nnnon je ne savais pas, mais chez vous, monsieur mon cousin, c’est votre fille Caroline qui est la petite dernière…
– Oui, si tu veux. Et Henri, qu’a-t-il fait aujourd’hui ?
– Eh bien, monsieur mon Cousin, votre aîné a toujours besoin d’un enseignement solide et fidèle… Nous nous entendons très bien… Quant à Frédéric, c’est un enfant modèle…
– Oui, c’est le plus grand virtuose de la famille, mais il est un peu… ennuyeux.
– Oh monsieu…
– Ne dis surtout pas cela à sa mère… Mais jamais il n’aura ce grain de folie qu’ont tous mes autres fils, et moi-même aussi d’ailleurs : c’est cela qui nous fait sortir du lot innombrable des musiciens ordinaires…
Je restai un moment dans un silence que Jean-Elias sut respecter.
– Ah dis moi et ces œillets ? Ma femme m’en parle tous les jours. Il faut les planter maintenant, tu le sais !
– Mais, monsieur mon cousin, j’ai déjà écrit plusieurs fois.
– Sais-tu qu’il y en a des jaunes et des bleus ?
– Ah bon, parce notre maman en voudrait aussi des bleus… Je vais écrire à nouveau…
– Tu sais que j’aimerais bien connaître ta ville de Schweinfurt. Mais là-bas au sud, au delà de ma forêt de Thuringe, cela me semble bien loin.
– C’est un beau pays, monsieur mon cousin, où il fait bon vivre. Et puis c’est de là que viennent les bons vins doux de Franconie et notre bonne eau de vie.
– Ils sont aussi bons que les vins qu’on boit ici ? Crois-tu qu’ici ils plairaient ?
Jean-Elias avait enfin compris car il me répondit :
– Monsieur mon cousin, accepteriez-vous, que, pour vous montrer ma reconnaissance, j’en fasse venir quelques mesures ici ? Je vais écrire… Car si je pars bientôt…
– Partir, bientôt, toi ? Mais il n’en est pas question, Jean-Elias, ce n’est pas possible. Tu as la responsabilité de mes enfants, tu me rends beaucoup de services pour les écritures, tu fais partie de la famille… et puis tu as un contrat de trois mois.
Jean-Elias semblait hésitant, comme s’il voulait me dire quelque chose, puis sembla y renoncer. Je n’avais aucune envie qu’il continue à me parler de son départ.
– Au fait qu’as-tu trouvé d’intéressant dans les librairies ?
– Je trouve beaucoup de choses dans les catalogues, en particulier celui de Rüdiger, mais les livres sont chers.
Jean-Elias consultait beaucoup Rüdiger, car ce catalogue était gratuit.
– Bien, nous allons travailler maintenant. Apporte-moi, la partition qui est là-bas sur l’étagère.
– Voici…
– C’est la cantate qui commence par : « J’en ai assez ».
Je vais te demander de copier… Eh bien tu vois, là… mais on n’y vois rien ici, il faut changer de chandelle. Apporte m’en une autre…
– Mais c’est la même que d’habitude…
– Apporte m’en une autre, te dis-je…
Avec deux chandelles je pus lire la partition. Cela me surprit un peu mais je n’y pris pas garde…
– Bon maintenant, je vais te dicter une lettre… Ensuite tu iras la porter à…
– Mais vous savez bien, monsieur mon cousin, que je ne peux pas faire une lettre directement comme cela. Il faut que je fasse un brouillon avant…
Jean-Elias avait la manie de faire des brouillons. Moi je trouvais que cela gâchait du papier et du temps. Mais il les rédigeait dans un cahier « pour avoir des traces » disait-il.
– Bon c’est une lettre pour ton ami Koch, Cantor à Ronneburg. Quand il est venu ici prendre des cours avec moi…
– Je vous remercie, monsieur mon cousin d’avoir accepté d’accueillir cet ami si…
– C’est très gentil à lui de m’avoir fait parrain de sa fille et de m’avoir invité au baptème. Mais tu vois que je suis débordé. J’ai dû aller à Altenburg pour cet orgue… D’ailleurs le site est splendide, le château et la chapelle sont construits sur le flanc d’une colline abrupt…
– Pourtant Altenburg est à quelques kilomètres de Ronneburg dans la même direction et le baptême était trois jours après votre concert: tout était combiné…
– Des reproches, Jean-Elias ?
– Non, non, pas du tout, monsieur mon Cousin, d’ailleurs ils ne vous en veulent pas puisqu’ils vous ont envoyé une partie de ce qui restait…
– C’était très bon d’ailleurs. Bien ! Dans ta lettre dis leur bien que j’exprime à Monsieur le Cantor et à Madame son épouse, outre mes sentiments les plus dévoués, « mes » remerciements pour les beaux morceaux de la cérémonie qui ont été consommés à leur santé.
– Attendez, vous allez trop vite !
– Dis leur aussi que je suis débordé, que je recommence mon Collegium Musicum et que je vais jouer pour l’anniversaire…
– Je ne suis pas, monsieur mon cousin, vous allez trop vite…
– …du Roi et que j’aimerais qu’il vienne, lui, ici…
Quand notre travail se prolongeait, le visage d’Anne, notre maman, apparaissait, au bord de la porte, et elle nous regardait en souriant, sans rien dire, comme si elle ne voulait pas gêner. Ce sourire avait le don de me faire fondre de tendresse. Même si l’âge commençait à laisser des traces sur son visage et sur son corps, elle restait pour moi cette jeune fille espiègle et sérieuse, bonne chanteuse et bonne musicienne, qui faisait ma joie.
– Qu’y a t’il, notre maman, tu parais impatiente de nous parler.
– Vous avez bientôt fini votre travail ? Eh bien oui, je suis impatiente: car on m’a parlé d’un oiseau qui chante !
– Un oiseau ?
– Mais oui, il paraît qu’il y en a un qui s’appelle la linotte mélodieuse et qu’on peut mettre en cage. Et on peut lui apprendre à chanter. Comme j'aimerais en avoir un! Allons, venez vite, les deux travailleurs !
Elle quitta la pièce puis revint :
– À propos, Jean-Elias, as-tu des nouvelles de mes œillets ?
Jean-Elias eut l’air consterné. Et elle redescendit enfin.
Jean-Elias et moi nous retrouvions seuls.
– Jean-Elias !
– Oui ?
– Pour l’oiseau, rien ne presse…
– L’oiseau ?
– Oui, cette linotte mélodieuse.
– Ah oui !
– Mais bien sûr, si par le plus grand des hasards, on t’en propose un, accepte-le: mais nous nous arrangerons pour qu’il soit mis assez loin de ce cabinet de travail…
Pour la première fois depuis le début de notre séance de travail, je vis Jean-Elias sourire : il avait compris.
Quelques temps après, je pus enfin avoir à Leipzig le jeune Goldberg comme élève. Il était venu de Dresde avec Guillaume et le Baron. Il s’avéra un élève remarquable.
Je lui apprenais la théorie de la musique avec d’autres élèves au premier étage dans mon cabinet de travail. Un soir, comme nous descendions, j’entendis Anne qui jouait un air que j’avais composé en prenant une basse de quelques notes formant une cadence très simple. Elle l’avait recopié dans son petit livre à couverture verte. Guillaume sursauta. En le voyant, notre maman s’arrêta. Je n’eus pas le temps d’intervenir: il s’assit à sa place devant le clavecin et, reprenant la même basse, improvisa sur le mode mineur une pièce d’une telle profondeur que tout le monde en fut fort ému. Je croyais que seuls les Italiens ou les Français étaient capables… Je fis un signe et je pris sa place : toujours sur le même thème je me mis à jouer à la façon de Domenico Scarlatti. Ces Scarlatti étaient un peu les Bach de l’Italie, une grande famille de musiciens. Ce Domenico avait publié deux ans auparavant une série de pièces pour clavecin tout à fait remarquables.
Je m’arrêtai puis demandai à chacun des élèves qui étaient là d’improviser un canon sur ce thème.
– Écoutez, voilà ce que nous allons faire : toi Agricola, tu vas faire un canon avec la deuxième voix démarrant à l’unisson. Toi, Kirnberger, dans le canon que tu vas improviser, la deuxième voix devra démarrer un ton au dessus. Toi, Agricola, une tierce et ainsi de suite. Vous avez un quart d’heure pour construire cela dans vos têtes et me le jouer après.
Frédéric s’était approché :
– Je peux jouer aussi ?
– Et moi ? dit le cousin d’Eisenach.
– Bien sûr !
– Et moi ? dit ma fille Liesgen.
– Essaie, on verra bien ce qu’une femme peut faire !
Elle me regarda avec un air de reproche, puis rougit et me dit :
– Ce n’est pas ce que tu dis de la Faustina, Père.
Je préférai sourire de l’effronterie de cette petite fille de 15 ans.
Ensuite chacun joua selon sa manière : ce fut très réussi.
Alors Henri s’avança : pour une fois il souriait mais avec malice, il s’assit au clavecin. À notre stupéfaction, il se mit à chanter une chanson :
– « Cela fait si longtemps que je ne suis près de toi : viens plus près, viens plus près ».
Et pendant qu’il chantait, il se mit à jouer les notes de basse : cela collait parfaitement. Alors nous fîmes tous cercle autour de lui, et je fis signe à notre maman de s’approcher de moi. Une idée m’était venue et sur ce que faisais Henri, je me mis à chanter une autre chanson :
– « Choux et raves m’ont fait fuir : si ma mère avait cuit de la viande, je serais resté plus longtemps ».
Les deux chansons et le thème de basse allaient tous trois très bien ensemble !
Dans la joie et la gaieté, nous nous sommes tous mis à chanter : mes enfants, notre maman, mes élèves préférés, tous étaient arrivés. Exactement comme autrefois dans nos réunions de famille. La soirée fut longue et joyeuse.
Au moment ou nous allions nous quitter, Goldberg s’approcha de moi.
– Maître !
– Oui, mon petit Goldberg, qu’y a t’il ?
– Vous savez que le Baron me demande de jouer du clavecin quand il somnole. Je crois que si vous pouviez écrire quelque chose comme ce que nous venons de faire…
Je fus tout à coup transporté hors du temps: des variations libres sur un seul thème et dans un seul ton, mais formant un œuvre pleine de variété, présentant tous les styles, tous les genres, avec de multiples correspondances de chiffres et de symboles, avec des canons, des fugues, des chansons, des… Il en faudrait beaucoup, peut-être
– Une pour chaque jour du mois
Je m’étais mis à parler tout haut sans m’en rendre compte.
– Qu’y a t’il, Sébastien ?
– Qu’y a t’il, papa ?
– Qu’y a t’il, maître ?
– Euh… je pensais à ton maître, mon petit Goldberg, une variation par jour du mois pour qu’il dorme, qu’en penses-tu ?
– Comment ! Trente variations sur un même thème, mais cela ne s’est jamais fait !
– C’est bien pour cela que je vais le faire !
Tous les regards convergeaient sur moi. J’étais heureux.
Seule ombre au tableau : Emmanuel n’était pas avec nous ce soir-là. Il était même très loin, quelque part au nord de Berlin, dans une petite ville appelée Rheinsberg. C’était là que vivait le fils de celle que j’avais rencontrée à Celle, dans ma jeunesse… Elle avait épousé le roi de Prusse, ce roi-sergent, plus large que haut, que j’avais aperçu quand j’étais allé chercher un clavecin à Berlin pour mon cher Prince de Cöthen. De ce roi-sergent elle avait eu un fils que son père avait exilé dans cette petite ville de Rheinsberg, dans un joli château tout entouré d’eau et de lacs. Ce fils était le petit Fritz qui m’avait vu, émerveillé par ma flûte et qui avait voulu essayer d’en jouer. Il était Prince héritier. Comme sa mère, il adorait la musique et la flûte : il en jouait comme un prince peut jouer de la flûte. Je crois que sa mère n’avait pas été étrangère au fait qu’il avait choisi Emmanuel pour l’accompagner au clavecin. La place d’Emmanuel était enviable car un jour ce prince deviendrait roi.
Et c’est effectivement ce qui arriva : le roi sergent mourut le dernier jour de mai 1740. Le jeune Fritz prit le nom de Frédéric II de Prusse et Emmanuel fut nommé claveciniste de la Chambre du roi. J’eus dès lors très envie d’aller le voir à Berlin. Mais c’était un long voyage et à cette époque, je voulais travailler à mes variations et à mon second volume du Clavier bien tempéré, sans compter ce cahier de fugues et de contrepoint : j’étais débordé de travail. Je ne pouvais m’éloigner que pour de courts voyages à Weissenfels, dans la famille de ma femme, qui était aussi celle des Krebs, ou à Halle où je gardais des contacts chaleureux avec mon ami Becker.
Ce n’est donc que durant l’été 1741 que je pus me rendre à Berlin. Pendant ce voyage, j’écrivis plusieurs lettres à ma femme bien aimée. C’était pour moi une grande tristesse de ne pas l’avoir auprès de moi. La ville avait retrouvé son lustre : Frédéric II, le nouveau roi, faisait construire à Potsdam un château qu’il appelait « Sans Souci ». Malgré le souhait qu’il avait exprimé, je ne pus le rencontrer lors de ce premier séjour car il était parti en guerre. La reine mère habitait toujours le château de Monbijou.
Mon fils était débordant d’activité : il me montrait ses œuvres, m’expliquait ses projets : comment deux fils issus d’un même sang pouvaient-ils être aussi différents que Guillaume et Emmanuel !
– Emmanuel, si seulement tu pouvais venir à Leipzig pour que nous soyons à nouveau tous réunis.
– Mais je suis bloqué ici, le roi peut me demander à tout instant.
– Tu ne peux pas lui dire que tu pars en voyage ?
– Toi, tu peux te permettre de dire ça à ces autorités de Leipzig dont tu te plains toujours, mais qui te laissent quand même partir…
– Oui, mais je n’ai pas ton âge…
– Eh bien essaie plutôt de venir ici avec Guillaume, ce serait « Sans Souci ».
– Quand cesseras-tu tes jeux de mots…
À ce moment, notre hôte, le docteur Stahl entra. Il était dos à la fenêtre et, en me tournant vers lui, je fus obligé de fermer les yeux un instant car la lumière m’éblouissait. Il me dévisagea :
– Vous devriez vous reposer, monsieur Bach. Je vois cela à votre teint et au fait que vous clignez des yeux, comme si la lumière vous gênait. Voulez-vous que je vous examine ?
– Ce ne sera pas nécessaire, monsieur, je suis déjà suivi à Leipzig par un de vos confrères qui m’a dit la même chose.
– Bien, comme vous voulez, cher maître. Voici un courrier pour vous.
Je lus :
– Voyons… "Très noble et estimé Monsieur, Très estimé Monsieur mon cousin". Commençant comme ça, ce ne peut-être que Jean-Elias.
"Voyons… vous avez envoyé… bonnes nouvelles … Bonne santé"
Je regardai notre ami médecin qui m’adressa un regard de reproche.
– Ah mais qu’est ceci : « Notre digne Maman », c’est ma femme, « ne se sent pas bien depuis huit jours et on ne sait pas si ce violent échauffement du sang »… Vous pensez que c’est grave, docteur ?
– A-t-elle déjà eu cela ?
– Oui, en début de grossesse, mais je doute que… Je poursuis : Ah je savais bien qu’ils ne me laisseraient pas en paix ! Écoutez ceci : "la Saint Barthélémy… et les élections du conseil tombent dans peu de semaines, nous ne savons pas comment agir en votre absence"… Quand je suis là, ils protestent et quand je ne suis pas là, ils me réclament. Ils font tout pour que je revienne. Tu vois il ne peuvent pas préparer une fête sans moi…
– Mais papa, c’est un peu normal, tu es directeur de la musique…
– Alors toi aussi, tu veux me donner des leçons ? dis-je en éclatant de rire.
– Tu n’es pas inquiet pour notre maman ?
– Penses-tu ! Elle est solide comme un roc. C’est un prétexte que les autorités ont soufflé à Jean-Elias pour me faire revenir !
Je reçus trois jours après une lettre prétendant que notre maman était au seuil de la mort.
Quand je revins à Leipzig, je la trouvai effectivement fatiguée mais une grande joie inondait son visage : elle me confirma que Dieu nous apportait un nouvel enfant. C’était vraiment un signe divin car elle avait presque 40 ans : cela me rappelait l’histoire de Sarah dans la Bible. Pour qu’elle ne se fatigue pas, je dictai à Jean-Elias pour nos amis de Weissenfels chez qui nous devions aller une lettre qu’Anne signa : cette expliquait qu’elle regrettait de ne pouvoir venir mais était souffrante et ne pouvait se déplacer.
Pendant la grossesse de notre maman se produisit une bien étrange aventure dont Jean-Elias, toujours à l’affût des nouvelles, se fit un plaisir de nous raconter tous les détails. Il arriva un jour en courant, tout échauffé et tout excité. Je pensai tout de suite à quelque catastrophe imminente. En fait il s’agissait de notre corecteur le sinistre Dresig, l’adjoint d’Ernesti : il s’était suicidé. Personne ne parla à ce propos de l’attitude méprisante et blessante qu’avait toujours eu Ernesti à son égard. Ce suicide ne contribua bien évidemment pas à améliorer l’ambiance qui régnait dans l’école. Je préfère d’ailleurs à ce propos citer un brouillon du cahier de Jean-Elias qui traînait souvent dans mon cabinet de travail. C’est celui de la lettre que Jean-Elias envoya à un des amis qu’il s’était fait à Dresde, lors de son voyage avec moi. Voici comment il avait vu les choses :
"J’aurais bien voulu aussi vous donner plus de détails sur feu le recteur Dresig, mais on ne sait pas ce qui a pu le pousser à commettre cet acte de Judas. On l’explique par exemple par le fait qu’il avait essuyé le refus de certaines femmes, qu’il avait contracté de nombreuses dettes etc., etc. Mais la vraie raison pourrait bien être qu’il avait abandonné son Dieu, puisqu’on dit qu’il avait souvent parlé religion en termes moqueurs. Il s’est pendu par la collerette dans le fossé derrière la maison du Pasteur près du jardin Wagner et a connu une fin affreuse. C’est un exemple bien singulier qui a surpris tout Leipzig".
Bien sûr, toute la famille fut très impressionnée par cette nouvelle impossible à cacher aux enfants. Heureusement notre petite fille vint au monde peu après, en pleine santé, le 22 Février 1742. Elle reçut le joli nom de Suzanne. Elle avait 34 ans de moins que sa sœur aînée Catherine et 5 ans de moins que sa plus jeune sœur Caroline. Désormais nous avions 7 enfants sous notre toit (si je compte Catherine et Henri). 9 de mes enfants étaient vivants, dont 6 d’Anne. Ces chiffres me paraissaient d’une haute valeur symbolique.
J’étais heureux que la maison soit à nouveau pleine. Mais cela signifiait aussi pour moi le devoir d’élever ces enfants et de les mener à l’âge adulte. Ma paye fixe de Cantor représentait peu de choses par rapport à mes besoins, et c’est une des raisons pour lesquelles j’avais tant d’activités différentes. Grâce à ma réputation et à ma situation auprès de la cour de Dresde, j’étais demandé de toutes parts : pour l’enseignement à des élèves privés, pour des examens d’orgues, pour des concerts, pour des commandes de musiques de fête, pour des cérémonies religieuses… Chez moi on pouvait aussi acheter des partitions de moi, de mes fils ou d’amis. Tout cela nous procurait des revenus tout à fait acceptables.
Je bénissais le ciel que Dieu me garde en pleine santé.
J’avais terminé les trente variations auxquelles je donnai encore une fois le titre de « Exercices pour le Clavier » mais j’y ajoutai « comprenant un Air avec différentes variations pour clavecin à deux claviers ».
Le Baron apprécia beaucoup et Goldberg les jouait remarquablement. Mon Dieu, qu’il était doué, ce garçon : quand il composait, il respectait toutes les règles de l’harmonie, ses fugues et ses canons étaient parfaits. Mais, dans ses compositions, il manquait justement ces petits écarts, ces légères entorses aux règles qui font toute la saveur de notre art.
Comme je l’avais promis aux enfants, j’avais mis aussi en ordre et complété la seconde série de 24 préludes et fugues, exactement sur le même schéma que le Clavier Bien Tempéré que j’avais créé 20 plus tôt à Cöthen.
Mon cahier d’exercice de contrepoint et de fugues m’occupait aussi beaucoup. J’en fis une première ébauche qui comprenait 12 fugues et deux canons. Je montrai ce projet à mes élèves en leur expliquant les différents types de fugue que je traitais. L’un d’eux (peut être Altnickol ou Kirnberger ou peut-être encore le fidèle Kriegel, qui donnait les cours de latin à ma place, je ne sais plus) me dit un jour :
– Mais maître, c’est un véritable Art de la Fugue que vous êtes en train de concevoir !
Je souris :
– Oui, c’est un peu ça !
Quoi qu’il en soit, je n’avais pas assez de temps pour donner à ce projet sa forme définitive. Je me promettais de revenir sur ces manuscrits dans un avenir qui me laisserait peut-être le loisir de revoir celles de mes œuvres qui me tenaient le plus à cœur. Fallait-il vraiment souhaiter que ce temps vienne un jour ?
La composition de musiques d’église ne fut toujours pas, pendant ces années, ma préoccupation essentielle. Le plus souvent je dirigeais ou jouais ce que j’avais déjà composé en le modifiant légèrement selon les circonstances. J’interprétai aussi les œuvres des autres. Il m’arrivait de les adapter. Il y en eut beaucoup mais je me souviens tout spécialement de l’une d’elles intitulée Stabat Mater de Jean-Baptiste Pergolèse, un jeune musicien italien mort à 26 ans, cinq ou six ans auparavant. On racontait qu’il avait composé cette oeuvre très peu de temps avant sa mort. Cette musique était si belle qu’elle provoqua en moi une émotion inexprimable : nous ne surpasserons jamais les Italiens et parfois les Français pour exprimer certains troubles de l’âme. Le texte, en latin, évoquait la douleur de la vierge Marie au pied de la croix : il convenait mal au culte luthérien. Je fis adapter le texte en allemand d’après le psaume 51 « Miserere » qui parle de notre douleur dans le péché. Je modifiai dans la musique certains passages en rendant plus denses certaines parties de violon.
C’est en août 1742 que je reçus une commande qui me procura beaucoup de joie et d’amusement. Il s’agissait d’une musique pour célébrer le commissaire du roi, chargé des impôts, Monsieur de Dieskau, qui s’était vu attribuer des terres au sud de Leipzig. Sous ses ordres était Picander, mon ami et librettiste, avec qui j’avais si souvent travaillé. Ce haut personnage nous convoqua, Picander et moi. Il nous envoya son carrosse qui nous emmena sur la route de Weissenfels et arriva après quelques kilomètres devant un charmant manoir.
Je m’attendais à voir en Monsieur de Dieskau un de ces sinistres employés à la mine sombre et rébarbative mais, à ma grande surprise, je me trouvai devant un jeune homme d’une trentaine d’années, souriant et cordial qui se leva pour venir nous serrer la main.
– Messieurs, je vous ai demandé de venir car je veux que mon arrivée ici soit l’occasion d’une grande fête. J’ai déjà commandé un splendide feu d’artifice. À présent je veux vous commander un spectacle. Si je vous ai choisi Monsieur Bach, c’est bien sûr parce que vous êtes un musicien illustre et qui plus est un musicien du roi. Mais c’est surtout parce qu’on m’a dit que vous aimiez surprendre.
– ? ? ?
– Attendez, vous en saurez plus tout à l’heure. Picander, je vous ai choisi parce que je trouve piquant que celui qui va faire le texte du spectacle, soit justement chargé de percevoir des impôts.
– Monseigneur, je vous remercie de l’honneur que vous me faites.
– Picander, je voudrais que ce texte soit original et c’est pour en trouver la trame que je vous ai demandé de venir avec Monsieur Bach…
Picander fit semblant de réfléchir un instant puis, comme pris d’une inspiration soudaine :
– Monseigneur, je vous verrais bien en Apollon, qui tel un soleil levant est entouré d’étoiles qui pâlissent…
– Vous n’y êtes pas du tout, mon brave Picander…
Picander ne se laissa pas décourager :
– Ou alors Hercule qui entreprend les travaux…
– Écoutez Picander, vous ne comprenez pas ce que je veux : je veux recevoir ici les gens de mes terres, les paysans, les humbles, le peuple et je veux qu’ils s’amusent, qu’ils dansent, qu’ils boivent, qu’ils aillent folâtrer, qu’ils soient gais, qu’ils plaisantent, qu’ils se sentent libérés pour un instant des soucis de leur vie quotidienne… Tenez, je voudrais comme je l’ai déjà vu, un spectacle où l’on n’hésite pas à se moquer des notables.
– Même de vous ?
– Mais bien sûr ! Et aussi du curé, du percepteur, de l’avocat… Et c’est là que je vous demande de surprendre, monsieur Bach : faites moi une musique de village et non pas une musique de cour.
L’idée m’enchanta tout de suite. Picander, le bon Picander se défit tout à coup de son ton solennel et il eut un large sourire. Il dit en me regardant :
– Je vous avais bien dit, Monsieur le Cantor, que je vous ferais un jour mettre en musique des paroles un peu lestes…
Un rire de bon augure nous prit tous les trois et Monsieur Dieskau prit congé :
– Je vois que vous avez compris. Revenez me voir dans quelques jours.
Rarement je me suis autant amusé qu’en travaillant à cette comédie avec Picander. Ma musique n’avait rien de savant et empruntait à des chansons de l’époque, elles se succédaient à des rythmes différents.
Une jeune femme essayait de chanter comme les nobles, un jeune homme aussi, mais ils préféraient tous aller à la taverne. Picander s’était surpassé en écrivant des textes gais, brefs et drôles :
– Allons Marion, donne-moi ta jolie bouche.
– Si tu ne voulais que ça ! Mais je te connais, espèce de bon à rien, tu en veux toujours plus !
– Ça gronde dans mon ventre : comme si une armée d’abeilles se battaient.
– Monsieur le percepteur, laissez-nous au moins notre peau !
Le jour de la représentation, le temps était digne d’une fin d’août. Il se trouve que le Roi était à Leipzig ce jour-là. Sur la pelouse devant le manoir, ces gens de la campagne dansaient au son de la cornemuse. Miroir de notre spectacle, cette pelouse était devenue la taverne. Le vin et la bière coulaient à flots. J’en profitai aussi. Depuis quelques temps, je prenais de plus en plus de plaisir à manger et à boire, et ma corpulence s’en ressentait !
Ce mois d’août 1742 avait été fort occupé : l’anniversaire du roi en début de mois, et, trois jours avant cette fête de paysans, l’élection du maire.
Tout le monde admirait ma forme et ma vitalité. Comble de bonheur, j’eus la joie d’acquérir deux jours plus tard dans une vente aux enchères La Grande Bible Allemande de Luther, dans l’édition de Carlov : cela me coûta 5 000 F, à peu près 10 % ce que m’avait donné Dieskau pour ma musique !
Je vivais alors une époque bénie.
Après avoir retardé son départ le plus longtemps possible, je laissai enfin partir Jean-Elias et c’est en cette fin d’année 1742 qu’il nous quitta : la saison était froide et je dus lui prêter mon manteau et mes bottes pour le voyage. À 37 ans, le pauvre garçon n’avait même pas de quoi s’habiller pour un voyage ! Je trouvai vite, parmi mes élèves qui pour la plupart poursuivaient leurs études à l’Université, des solutions pour le remplacer.
Jean Frédéric Doles était l’un d’eux : en 1743, il devait avoir une trentaine d’années et cherchait toujours à paraître plus vieux que son âge pour être mieux considéré: heureux homme ! Il était né en Thuringe, non loin d’Ohrdruf, et comme à tous les thuringiens, je lui avais fait bon accueil. Quand il arriva à Leipzig, il quittait un poste de préfet de chœur et cherchait à devenir cantor. Il était doué et très curieux de musique moderne. Il gagnait sa vie en donnant des leçons de musique aux bourgeois de la ville. Je me souviens de discussions épiques entre lui et mon fils Guillaume à propos de l’évolution de la musique.
– Mais voyons, Doles, les bourgeois sont incapables de comprendre la musique !
– Détrompe toi, Guillaume, ils sont en train de changer : la musique est sortie des églises et des cours des princes.
– Tu sais, depuis toujours, les paysans dansent au son des cornemuses et chantent des chorals le dimanche… Si c’est ce que tu appelles la musique…
– Allons, ne sois pas emporté, tout de suite.
– Et puis… tu sais bien que seuls les étudiants ont le temps de faire de la musique, les bourgeois sont trop occupés…
– Allons, Guillaume, regarde ce que fait ton père chez Zimmermann… Les bourgeois y viennent pour écouter de la vraie musique.
– S’il n’y avait pas le café, ils ne viendraient pas… D’ailleurs, ils viennent de moins en moins.
– Mais c’est parce que les étudiants ne sont pas payés et sont de moins en moins bons…
– Ah ça c’est vrai, je ne dis pas cela pour toi, Doles, mais le niveau baisse. Il faut dire que, comparé aux professionnels de Dresde, c’est un autre monde ! Et puis, quand je pense à la place qu’on donnait à la musique de mon temps à l’école, c’est normal après tout que le niveau baisse ! Tu te rappelles, père, dit Guillaume en se tournant vers moi, avant Ernesti et consort, de la qualité de nos orchestres d’étudiants ?
– Eh bien, justement, dit Doles, je peux te certifier qu’il y a à Leipzig un public de marchands et de notables prêts à écouter de la musique avec de bons musiciens.
– Oui, mais les bons musiciens peuvent jouer aussi bien de la musique pour chiens que de la bonne musique !
– Et alors, c’est le public qui choisit, non ?
La pipe à la bouche, j’écoutais les deux jeunes hommes : tous deux avaient raison sans doute… Je les interrompis par une question à Doles :
– Tiens, à propos, où en est Gleditzsch ?
Doles devint rouge d’embarras.
– Vous… vous connaissez Monsieur Gleditzch ?
– Bien sûr, sa femme a même été marraine d’un de mes enfants.
– Mais alors il vous a dit…
– Il aurait été tout de même étrange qu’il ne me tienne pas au courant.
– Alors vous savez que depuis deux ans, il met sur pied un Grand Concert, qui comprendra…
– Seize membres qui acceptent de payer 10 000 F par trimestre et seize musiciens qui sont en train d’être sélectionnés…
– Et vous savez que je…
– Que tu es des leaders de ce groupe. Je sais aussi que tu aurais pu me le dire avant, mon petit Doles…
– Mais maître, mai…
Guillaume éclata de rire :
– Avec ce genre de gaffe, tu n’es pas près d’être cantor !
J’ajoutai en souriant :
– Je sais même que Gerlach en fait partie aussi. Ceci dit, je crois que les orchestres d’amateurs ont aussi du bon et qu’ils ont leur place à côté de ce Grand Concert que tu vas contribuer à créer. Quant à moi, je continuerai chez Zimmermann, mais peut-être pas aussi souvent qu’avant.
– Maître, pardonnez mon insolence, mais Gleditzsch vous a t’il proposé de…
– Ah ça, mon petit Doles, tu le sauras bien assez tôt.
Je n’étais pas mécontent que les choses tournent ainsi, car cela me rendait plus libre de participer à tel ou tel concert selon mon envie… et mes besoins financiers du moment.
Ce que je n’avais pas dit à Doles, c’est que la musique avait atteint un tel état de décrépitude à l’école en raison de l’attitude d’Ernesti, que les bourgeois et marchands s’en étaient émus et avaient proposé de verser plus d’argent pour l’enseignement de la musique à l’école : nous allions peut-être pouvoir un jour payer les adultes qui tenaient les parties de basse dans le chœur.
La mort du fils de Christian Weise, en avril 1743, pendant la période de Pâques, m’attrista énormément. La nuit où il mourut sa femme accoucha de deux enfants jumeaux. Il n’avait pas 40 ans. Avec lui disparaissait une lignée d’hommes exceptionnels, symboles des temps passés, période de foi profonde, que j’avais vécue avec tant de ferveur ! La cérémonie eut lieu à Saint Nicolas et le surintendant Deyling fit un sermon s’inspirant du prophète Isaïe : « Voici le Dieu de mon salut, j’ai confiance et ne tremble pas ».
Cette mort fut suivie d’une période sombre : on parlait de guerre.
Les routes n’étaient plus sûres. Des soldats parcouraient la campagne en pillant les paysans et en volant les voyageurs. Je ne pus même pas aller à Berlin au mariage de mon fils Emmanuel au début de 1744. (La même année Ernesti se décida enfin à se marier : il avait presque 40 ans !). Bientôt, il ne fut même plus possible d’aller à Dresde ni même de sortir de la ville. Déjà le Roi avait quitté la Saxe pour la Pologne. On disait que les Français, alliés au Roi de Prusse allaient tout détruire. Ce que je craignais depuis que j’étais enfant arrivait : c’était la guerre.
Je me souviendrai toujours du 21 novembre 1745. Je travaillais dans mon cabinet. Je regardai machinalement par ma fenêtre. Vous savez que de là on surplombait les remparts et qu’on voyait au loin, les champs et la campagne. Parfois même, quand le temps était très clair, on apercevait, comme des épines posées sur l’horizon, les clochers des églises. C’était le cas, ce matin du 21 novembre 1745. Il faisait froid. Le ciel était si clair que je croyais avoir retrouvé ma vue de jeune homme : je voyais ces clochers, je voyais ces fines épines. Et puis, le long de la route, je vis comme une colonne de fumée qui montait jusqu’au ciel. Je me dis que c’était le vent qui soulevait la poussière et me replongeai dans mon travail. Combien de temps après ai-je à nouveau regardé par la fenêtre ? Toujours est-il que je vis, venant de l’horizon, s’approcher des soldats, des chevaux, des canons. Ils s’arrêtèrent derrière le jardin Appel. Puis j’entendis le son du canon. Je ne pus empêcher les enfants de monter : ils voulaient voir.
– Papa, papa, qu’est ce qui arrive ?
– Ne vous inquiétez pas dit Catherine, ma fille aînée, papa va tout arranger.
– Sébastien, qu’allons-nous faire ? dit notre maman
– Vont-ils entrer dans Leipzig ? dit Frédéric 15 ans
– Nous allons les battre, nous sommes les plus forts, dit Jean Chrétien, 12 ans
– Les deux petites filles s’étaient blotties dans les jupes de leur grande sœur
On entendait en bas les râles de Henri, 23 ans qui, quand il sentait un danger et qu’il avait peur, oscillait d’avant en arrière, toujours plus fort.
Liesgen, 21 ans, n’était pas là : je lui avais permis d’accompagner mon brillant élève Altnickol pour une course en ville.
Les notables n’avaient pas prévu de faire des provisions pour un siège. Les soldats étaient en trop petit nombre à Leipzig pour défendre la ville. Après trois jours, la faim commença à nous tenailler. Le duc de Weissenfels, qui avait succédé à Flemming comme chef de la garnison, dut se rendre au bout de dix jours. Les soldats prussiens entrèrent dans Leipzig. Sur ordre de leur roi, ils demandèrent une rançon si forte que la ville ne put payer. Chaque habitant dut alors verser une somme d’argent, en métal, en or ou en fourrage. Moi, je ne pouvais pas payer en musique !
Noël 1745 : des soldats partout. Aurais-je pu imaginer un Noël dans la guerre ?
Ils restèrent là un mois entier puis repartirent un matin, comme ils étaient venus. C’était le 1er Janvier 1746.
Tous les marchands disaient que la ville était ruinée.
Mais les marchands sont aussi prompts au désespoir qu’à l’enthousiasme. En réalité la ville n’avait pas été détruite. Pas d’incendie comme celui que j’avais vu à Mülhausen et qui restait gravé dans ma mémoire. Pas de destructions, seulement quelques pillages: les soldats de Frédéric II étaient maintenus dans une discipline de fer.
En réalité la fin de cette guerre marqua le début d’une période de paix et de grande prospérité. J’ose croire que les princes de ce monde se sont mis d’accord et que nous ne connaîtrons plus jamais la guerre.
Pendant ces années, j’eus de nombreuses commandes d’expertise d’orgues : le chantier de l’église Saint Jean à Leipzig (rappelez-vous c’est près de cette église dans les jardins que je jouais pour Zimmermann en été), celui de Saint Thomas, toujours en travaux, le chantier du splendide orgue de l’église de Naumburg, (construit par Hildebrandt, celui qui m’avait fait mon clavecin-luth et fut supervisé par Silbermann et moi), le chantier de l’église de Zschortau. Selon les cas je recevais entre 10 000 et 15 000 F, tous frais payés bien sûr.
En ce qui concerne ma famille, les nouvelles étaient excellentes : moi, je venais d’avoir soixante ans et j’avais toujours une santé sans faille. Simplement, ma vue n’était plus aussi fine qu’avant. Je remarquai aussi que j’avais besoin de plus en plus de lumière pour lire mes partitions : c’était sans doute aussi une conséquence de l’âge. De toutes façons ces détails m’importaient peu. Je n’avais pas le temps de penser à tout cela.
Guillaume avait déjà 36 ans et Emmanuel 32 !
Guillaume avait été nommé organiste à Halle. Après treize ans (treize ans déjà !) il avait démissionné de Dresde. Il avait trouvé à Halle un poste important car en même temps qu’organiste, il y était en plus, comme moi à Leipzig, directeur de la musique. Je priai le ciel que ses relations avec les notables de Halle soient meilleures que celles que j’avais ici à Leipzig. Car je connais bien mon fils : capable des pires maladresses tant il est tout entier tourné vers son art et aussi vers lui-même! Moi, au moins, je savais parfois avoir la souplesse nécessaire. Halle ! Que de souvenirs ! C’est là que j’avais inspecté avec Kuhnau cet orgue dont mon fils était désormais titulaire. C’est là que j’avais refusé le poste d’organiste malgré l’insistance des habitants. C’est là aussi que j’avais cru pouvoir rencontrer Haendel…
Emmanuel, quant à lui, poursuivait sa carrière auprès du roi de Prusse Frédéric II. Il était son accompagnateur officiel. Chaque soir, de 7h à 9h, il jouait du clavecin quand le roi jouait de la flûte. Contrairement à Guillaume qui est d’humeur plutôt sombre et fantasque, Emmanuel sait se faire des amis. Il tient sans doute cela plus de sa défunte mère que de moi. Ainsi il participe à tous les évènements musicaux et littéraires de Berlin.
Mais on me réclamait là-bas : mon fils m’écrivait que le roi lui-même voulait me voir et demandait souvent à Emmanuel pourquoi je ne venais pas. Et puis, il y avait mon premier petit-fils, né à Berlin pendant le siège de Leipzig. Je n’avais même pas pu aller au mariage de son père ! Mais j’étais aussi impatient d’écouter quel genre de musique on jouait à Berlin, si elle était vraiment différente de celle de Dresde. Les musiciens y étaient ils aussi bons ? Comment avaient progressé, en quittant Dresde et en venant à Berlin, tous ceux que j’avais bien connu : les frères Benda, Graun et surtout Quantz. Ils touchaient paraît-il des sommes astronomiques car ils avaient la faveur du roi. Avaient-ils avec mon fils créé un type de musique nouveau ?
Le Baron Keyserlink, qui d’ambassadeur à Dresde était passé ambassadeur à Vienne et venait d’être nommé à Berlin, auprès de Fredéric II me conseillait lui aussi de répondre à l’invitation du roi de Prusse.
J’hésitai longtemps à venir. Je me demandais quel accueil me ferait la mère du roi. Qu’était-elle devenue ?
Je ne voulais pas non plus déplaire au prince électeur de Saxe et Roi de Pologne, le fils d’Auguste le Fort, qui régnait à Dresde et qui m’avait fait musicien de sa cour.
Ce souverain vint à Leipzig pour la Foire en avril 1747 : il séjourna du 24 avril au 6 mai. Or j’avais enfin prévu de partir pour Berlin le premier mai, donc pendant son séjour.
Notre maman me dit :
– Sébastien, tu ne peux pas partir maintenant voir le roi de Prusse à Berlin ! As-tu donc oublié qu’il y a à peine 6 mois, ses soldats occupaient Leipzig ? Il a vaincu le souverain dont tu es le musicien et qui est dans nos murs aujourd’hui, après deux ans d’absence ! Tu vas être banni, renvoyé ! Et nous serons à la rue !
– Allons, petite maman, reste calme, ma chère petite chanteuse, ma si bonne copiste et conseillère, ma tendre jardinière ! Réfléchis : je suis bien trop connu pour qu’il me bannisse. Et puis le souverain sait très bien que mes deux aimés travaillent pour le roi de Prusse: Emmanuel à Berlin et Guillaume à Halle. Tu sais, ils font tous semblant de ne plus pouvoir me supporter mais en réalité ils tiennent à me garder…
– Fais attention, Sébastien, il arrive toujours quelque chose quand tu pars en voyage… sans moi.
– Mais il faut absolument que j’aille là-bas ! Au fait, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi ?
– Sébastien, tu sais bien que c’est impossible !
– Alors, tu veux que je reste ici au risque de mécontenter le prince le plus puissant d’Europe qui fait travailler mes deux fils aînés ? Et s’il me proposait un poste à Berlin ?
– Sébastien ! Changer à ton âge ! Mais tu dois te ménager !
Notre maman m’avait parlé presque comme à un vieillard et non comme à un mari. Je ne voulus pas lui montrer combien cela me blessait: ainsi j’étais si vieux que cela ? Eh bien j’allais montrer au monde entier que j’étais en pleine forme : j’irais voir le roi de Prusse. C’était décidé.
– Écoute, petite maman, je crois que tu te fais du soucis pour rien. Je te promets d’en parler autour de moi et de ne pas partir si je vois que cela pose le moindre problème.
Le premier mai au matin, je partais pour Berlin. Je passai par Halle pour prendre Guillaume. Le voyage fut un vrai bonheur : le printemps était là, les arbres prenaient leurs feuilles, les oiseaux chantaient, cela me rappelait mon premier voyage avec Erdmann, à pied celui-là.
J’avais avec mon fils des discussions infinies. Il pensait qu’on pouvait faire de la bonne musique et parler au cœur sans qu’il y ait de contrepoint savant avec plusieurs voix. Moi je lui répondais que c’était vrai, que j’avais composé beaucoup d’œuvres à une voix, que j’avais entendu ses œuvres, que je les trouvais intéressantes mais que l’art suprême en musique c’était pour moi autre chose. Au delà du cœur, il y avait la recherche de cette délectation de l’âme qui permet d’atteindre des profondeurs inouïes. Et cela n’est possible que par des moyens que nos prédécesseurs, lentement, ont découvert et nous ont transmis, à travers leur musique, leur foi, leurs signes, leur langage secret dont la superposition des lignes mélodiques et le contrepoint sont l’aboutissement parfait.
En début d’après-midi, le dimanche 7 mai 1747 nous approchions de Berlin. Nous n’avions pas à nous rendre en ville car Emmanuel habitait près du Palais du roi, à Postdam, sur la route de Leipzig. Des gens d’armes nous arrêtèrent et nous demandèrent nos noms, ce qui eut le don de mettre Guillaume de forte méchante humeur.
Non loin du château, le logement qu’habitait Emmanuel était fort agréable. Il nous accueillit avec sa gentillesse habituelle :
– Alors, le père et le fils ont bien « Berliné » (Encore un de ses jeux de mots !). Entrez donc.
Je vis alors apparaître une charmante jeune femme qui tenait dans ses bras un bambin d’environ deux ans. Derrière elle se tenait un homme et une femme d’apparence agréable et joviale mais qui me dévisageaient comme si j’étais quelqu'être étrange. La jeune femme avait l’air si jeune que je fus fort surpris quand Emmanuel nous dit :
– Je vous présente Jeanne, ma femme, et Jean-Auguste, ton premier petit fils, père. Et puis voici les parents de Jeanne.
La jeune femme resta sans voix en me regardant.
Les parents s’inclinèrent respectueusement.
– Avant toutes choses, dis-je, je voudrais que nous rendions grâces à Dieu qui a permis que nous soyons réunis ici.
Je dis une prière puis je leur demandai de chanter avec moi un choral.
Après un instant de silence, Emmanuel prit la parole :
– Euh… voilà… Nous finissions de déjeuner et mon beau-père vous a fait une surprise…
– Oui, monsieur le Maître de Chapelle, j’ai choisi pour vous un excellent vin blanc, dit le père de Jeanne.
J’appris rapidement que le beau-père d’Emmanuel était négociant en vins. J’appris aussi, en goûtant le vin, que ce monsieur était un grand connaisseur.
– Mais je manque à tous mes devoirs, dit Jeanne. Vos bagages…
– Oui, je voudrais bien me changer car la route a été longue.
– Je vais vous montrer votre chambre.
À ce moment on entendit des coups violents contre la porte d’entrée.
– Ouvrez, au nom du roi.
Emmanuel se précipita et entrouvrit la porte.
– Le roi demande que Monsieur Bach père vienne immédiatement au château, son carrosse vous attend.
– Mais il faut que je me change, que je mette mon habit noir de Cantor.
– L’ordre du roi est que vous veniez sur-le-champ.
– Nous vous suivons, dit Emmanuel, sans montrer la moindre impatience....Le roi veut sans doute te faire écouter ses musiciens préférés…
Je regardais par la vitre du carrosse, je distinguai dans la brume les contours d’un bâtiment flambant neuf, splendidement décoré :
– Mais ce n’est pas le château que j’avais vu…
– Non, celui-là c’est le fameux Sans Souci… Le roi l’a inauguré lundi dernier mais ne l’habite pas encore… Nous allons au château que tu connais déjà. Tu sais que le roi a acheté à Silbermann plusieurs pianoforte. Je suis sûr qu’il va vouloir te les faire essayer.
– J’espère qu’il a acheté les plus récents car les premiers avaient un registre aigu détestable et de plus, il fallait taper sur les touches comme un forcené pour obtenir un son !
Mes deux fils se mirent à rire en se souvenant de mes discussions orageuses avec Silbermann.
– Rassure-toi, père, le roi prend toujours ce qu’il croit être le plus nouveau et le plus beau : il veut « acheter » un célèbre écrivain français du nom de Voltaire, et il a bel et bien « acheté » Leipzig récemment, tu en as été le témoin, père.
– Emmanuel, tes plaisanteries te joueront un mauvais tour.
Des laquais nous introduisirent dans l’antichambre du roi. J’étais fort gêné avec mon habit de voyage. Je me rassurai en pensant que nous allions écouter un concert avec le roi jouant de la flûte, car c’était son heure… Il était 19 heures.
L’attente ne fut pas longue : le roi me réclamait.
J’entrai dans la salle où se tenait le roi. Il y avait là beaucoup de monde. J’aperçus le Baron qui me fit un signe. Je reconnus tout de suite la mère du roi qui me sourit quand je passai devant elle et me regarda avec une insistance qui me gêna. Les ans avaient marqué son visage de toutes les déceptions et toutes les résignations qu’elle avait dû supporter. Le roi s’avança vers moi :
– Monsieur Bach, vous voici enfin… comme je suis aise de vous voir.
– Sire, je sollicite de votre gracieuse Majesté la plus grande indulgence car mes habits ne conviennent guère…
– Je vous pardonne volontiers car c’est moi le responsable…
– Je remercie votre majesté de son infinie complaisance à mon égard…
– Votre renom mérite bien…
– Je n’en suis que plus contrit de n’avoir pu faire honneur…
– Bien, ce la suffit, monsieur le Cantor, tous mes musiciens sont réunis ici ce soir : beaucoup sont de vos amis, je crois.
Un murmure de contentement parcourut les musiciens et Quantz se permit même de crier « Bravo » ce qu’il était le seul autorisé à faire en présence du roi.
– Mais je dois vous dire que parmi vos admirateurs les plus empressés figurent ma mère et ma sœur Anne-Amélie.
Il fit un geste montrant que je devais me diriger vers elles.
J’allai m’incliner d’abord devant la mère du roi, sans me mettre à genoux car mettre un genoux à terre était à présent pour moi un exercice un peu douloureux. Comme je m’approchai d’elle, je fus heureux de constater qu’elle avait repris une attitude digne de sa position. Mais je fus saisi de stupeur en voyant sa fille: je crus un instant voir la princesse avec qui, à la cour de Celle j’avais eu cette mystérieuse connivence. Mais c’était sa fille et non elle qui était là devant moi. Elle me sourit et me dit :
– Monsieur Bach, comme je suis heureuse de vous voir ! J’admire tant ce que vous faites.Vous ne le savez pas peut-être pas, mais moi aussi je compose.
Emmanuel vint se joindre à nous. Je le vis donner discrètement à la sœur du roi une feuille de papier sur laquelle je crus distinguer, malgré ma vue faiblissante, des notes de musique.
Alors le roi parla :
– Monsieur Bach, je vous ai réservé quelques surprises. Venez voir. Tout le monde nous suivit à l’exception de la mère du roi qui restait assise.
Il me montra un pianoforte de Silbermann du plus récent modèle, dont je savais qu’il sonnait bien.
– Allons Bach, montrez nous ce que vous pouvez faire avec cet instrument.
Je préludai et m’aperçus que l’instrument était mal accordé. En quelques minutes, le mal était réparé, si vite que j’entendis des oh ! d’admiration. J’improvisai puis m’arrêtai. Le roi daigna applaudir et tous s’empressèrent d’applaudir aussi. Il s’approcha de sa sœur, lui prit le papier qu’elle lui tendait, le lut attentivement puis le mit dans une des poches de son pourpoint.
Puis il m’emmena dans une autre salle et voulut que je joue sur un autre pianoforte. Je trouvai amusant de tester les différence de toucher et de sonorité entre les deux pianoforte.
Puis vint un autre pianoforte, puis encore un autre : il y en eut au moins une dizaine. Je voyais Emmanuel courir de salle en salle pour accorder les pianoforte avant que je joue. Je me demandai quand cela finirait. J’appris plus tard que ce roi avait acheté à Silbermann tous les pianoforte qu’il fabriquait ! Loin de m’impatienter, cette promenade dans le palais me détendait plutôt et je me préparais ainsi à l’épreuve qu’Emmanuel m’avait annoncée et qui était d’ailleurs habituelle chez les princes et dans les concerts. Le roi allait me demander d’improviser une fugue sur un thème qu’il me donnerait au dernier moment.
Je le vis regarder encore une fois la feuille de papier que sa sœur lui avait remise. Puis il me dit :
– Eh bien, monsieur le Cantor, vous nous avez fait entendre sur ces pianoforte une musique fort agréable, bien qu’assez différente de celle que je demande à mes musiciens. Et quel virtuose ! Votre fils lui-même…
Il sourit à Emmanuel et fit exprès de ne pas terminer sa phrase, ce qui mit l’assistance de fort bonne humeur…
Mais vous êtes ici pour nous montrer l’art dans lequel vous surpassez tout le monde : celui du contrepoint et de la fugue.
Il se dirigea vers un clavier, s’assit, se concentra et se mit à jouer quelques notes. C’était le thème qu’il avait choisi et qui m’impressionna fort par sa beauté. Improviser une fugue sur ce thème était un pari comme je les aimais : rien n’est impossible. Je vis mon fils Emmanuel sourire à la Princesse Anne-Amélie.
Je me concentrai.
Je vis dans ma tête la construction d’une fugue à 3 voix.
Je commençai à jouer.
Quand j’eus fini, je fus longuement applaudi, par le roi tout d’abord, tous les autres suivant.
J’entendis le roi dire à sa sœur, à voix basse :
– Vraiment c’est un tour de force, j’ai eu raison de le faire venir car après lui, on ne pourra plus entendre une chose pareille. As-tu suivi toutes les voix… ? Attends, je vais lui proposer autre chose.
Le roi ne savait pas combien mon ouïe était fine et que j’entendais parfaitement ce qu’il disait…
Je devinai la question qu’il allait me poser ensuite : faire une autre fugue sur le même thème mais avec six voix. Cela me paraissait impossible tout de suite.
Il me dit, comme s’il voulait me tendre un piège :
– Bach, pourriez-vous maintenant improviser une fugue… à six voix avec…
– …avec un thème de mon choix, si vous le voulez bien, sire.
Le roi eut un mouvement de surprise, marque un temps d’arrêt puis prononça ces mots :
– Eh bien soit !
Puis il regarda sa sœur et lui sourit d’un air triomphant.
À la fin de cette fugue qui je dois l’avouer me parut fort réussie, des applaudissements crépitèrent avant le roi lui-même. Je regardai qui avait osé… : c’était la jeune sœur du roi, Anne Amélie qui avait applaudi avant son frère.
À la fin de cette audition, elle vint vers moi, avec le même sourire, exactement le même sourire que sa mère à Celle, 47 ans auparavant au château de Celle et, s’éloignant de la foule. Elle m’entraina loin de la foule et me dit :
– Monsieur Le Maître de Chapelle. Oui je m’adresse en vous au Maître de chapelle et non au célèbre virtuose que mon frère a fait venir ici. J’ai eu en main la messe que vous avez faite pour la cour de Dresde.
– Princesse, vous êtes trop bonne et suis confondu de reconnaissance car les maigres talents que le ciel m’a donné ont pu ainsi être remarqués de votre gracieuse altesse.
Je ne savais plus trop ce que je disais. Je me sentais redevenir un jeune homme devant cette jeune femme qui pouvait avoir une vingtaine d’années. Je savais pourtant qu’elle était à la tête d’un couvent, le couvent de Quedlinbourg.
– Vous avez fait là une œuvre digne d’être connue des hommes et dont la mémoire devrait être gardée.
– Mais madame peu de musiques d’église sont jouées plusieurs fois : elles sont destinées à des offices précis, le musicien les joue une fois, deux fois, parfois trois fois, puis d’autres modes arrivent. Bien sûr, il y a quelques exceptions comme la Brockes Passion et en particulier celle de Telemann…
Je ne sais pourquoi, mais j’eus tout à coup l’impression que je doutais de mes propres paroles.
– Monsieur Bach, la Brockes Passion passera mais votre messe, elle, ne passera pas.
– Madame, vous êtes trop bonne et votre…
– La vie religieuse, monsieur Bach, m’a appris à comprendre ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas. De plus, comme je vous l’ai dit, je compose moi-même et je crois discerner la vraie valeur d’une œuvre, ce que mon frère ignore totalement…
Allais-je encore une fois être pris dans les confidences de cette famille ?
– Monsieur Bach, reprit-elle, je voudrais vous demander instamment de terminer votre œuvre. Ne faites pas de votre messe une simple messe luthérienne mais une œuvre universelle qui outre le Kyrie et le Gloria, comprendra le Sanctus, le Credo et l’Agnus. Faites m’en la promesse…
Elle avait pris un ton si sérieux que j’osai la regarder en face et lui dit, comme dans un acte de foi :
– Je vous le promets madame…
Dieu avait parlé par sa bouche. Chaque jour, depuis cette rencontre, j’allais penser à cette sainte mission que me donnait la Princesse. Chaque jour, je travaillerais dans mon esprit ou sur le papier à réaliser cette messe qui serait l’accomplissement de tout ce que j’avais conçu pour les musiques d’église. Chaque jour…
– Ma fille, que fais-tu avec Monsieur Bach, sais-tu qu’il est un séducteur !
La reine mère était arrivée sans que nous nous en rendions compte.
La mère et la fille me quittèrent, le passé tenant le bras de l’avenir. La fille se retourna vers moi. Son visage grave était devenu sourire radieux.
Quand je pense que le matin même de ce dimanche, j’étais encore en voyage…
– Père où étais-tu ? Tout le monde te cherchait ! Nous allons prendre congé du roi et partir car tu dois être fatigué.
C’était mon fils Emmanuel qui me ramenait aux choses d’ici-bas.
En rentrant un excellent repas nous attendait chez Emmanuel. Je n’éprouvai aucune fatigue.
– Et qu’y a t’il au programme demain ?
– Le roi nous attend à l’église du Saint Esprit pour que tu lui joues de l’orgue.
– Décidément il n’y en a que pour moi. Mais qu’en pensent les autres musiciens ?
– Oh ! tu sais, ils sont habitués… Le presse-citron est à l’œuvre…
– Le presse-citron ? Que veux-tu dire ?
– Quand le roi fait venir quelqu’un qu’il croit exceptionnel, il en tire tout ce qu’il peut et après n’a qu’indifférence à son égard. Comme un citron qu’on presse : une fois qu’il n’y a plus de jus, on le jette.
– Fais attention Emmanuel, ne va pas raconter que c’est toi l’inventeur de cette plaisanterie ! Mais… Quantz, les Graun et toi, Emmanuel, vous n’êtes pas des citrons.
– Nous, ce n’est pas la même chose, nous sommes pour lui des objets familiers, comme ses fauteuils, ses chaises, ses fusils ou…sa flûte, et dont il ne peut se passer.
Le lundi se déroula exactement comme l’avait dit Emmanuel : le roi insista sans cesse pour que je multiplie les tours de force. Non seulement je jouai pour lui à l’orgue de l’église du Saint Esprit mais le soir, il voulut encore m’entendre improviser une autre fugue à 6 voix. Il n’en fallut pas davantage pour me faire réagir. Dès ce moment je décidai que j’allais lui montrer que je n’étais pas un citron comme les autres. J’allai faire autour de « son » thème un nouveau recueil. Je le fis savoir et en parlai à mes deux aînés pendant ce séjour à Berlin.
– Je voudrais trouver un titre à ce recueil.
– Tu pourrais l’appeler Exercice pour le Clavier, comme tes œuvres précédentes.
– Mais non pour un roi, il faut autre chose.
– Pourquoi pas « Célébration pour le roi ».
– Mais non, ce n’est pas le roi que je veux célébrer, c’est la musique que je vais lui offrir.
– Tiens, voilà, j’ai trouvé le titre qu’il te faut : Offrande musicale à sa Majesté le roi de Prusse.
– Bonne idée ! Dès que je rentre à Leipzig, je me mets au travail.
– Promets que tu le feras éditer.
– Bien sûr, c’est devenu une habitude pour moi maintenant !
– Chez Schübler ?
– Oui, je pense…
– À propos, père, je ne t’ai pas félicité pour ta transcription pour orgue de 6 musiques avec choral extraits de tes musiques d’église ! Je les ai bien reçues et en ai même déjà vendu quelques unes. Tu as vraiment su choisir celles que nous préférions tous !
– Oui… cela m’a rappelé des souvenirs quand nous les chantions avec le chœur de Saint Thomas, dit Guillaume.
– Ne remue pas le couteau dans la plaie, mon fils. Quand je pense à la situation maintenant.
Je restai quelques jours à Berlin. Emmanuel me faisait visiter la ville. Un jour, il m’emmena au nouveau théâtre. J’entrai avec lui, regardai le plafond voûté et lui demandai tout de suite de monter avec moi dans la galerie supérieure.
– Regarde, Emmanuel, l’architecte a réussi un tour de force sans le savoir. Tu vois ces arcs brisés qui soutiennent le plafond voûté ?
– Oui.
– Eh bien, va à l’autre bout de la galerie et moi je reste là. Maintenant, tourne-toi vers le mur. Tu es prêt ?
– Euh… oui.
– Bon je parle tout bas, tu m’entends ?
– Mais très bien, c’est incroyable !
– Maintenant éloigne-toi du mur. Je vais continuer à parler tout bas. Voilà… tu as entendu ?
– Rien du tout. Mais comment pouvais-tu savoir ?
– Ah ça, mon fils, c’est l’expérience, l’observation et le travail !
Sur le trajet du retour, j’eus avec mon fils Guillaume une bien étrange conversation. Guillaume était depuis toujours celui à qui je livrai mes pensées les plus intimes. Nous étions parti tôt le matin après avoir pris congé d’Emmanuel.
Je regardais par la fenêtre de notre calèche :
– Le temps est brumeux aujourd’hui.
– Mais père, il fait un temps splendide.
– Ah bon !
Ma vue était-elle entrain de baisser à ce point ?
– Père, tu as entendu ce qu’a dit le roi ?
– Quand ?
– Il a dit en parlant de toi « après lui, on ne pourra plus entendre une chose pareille ».
– Oui et alors ?
– Père, je voudrais te dire quelque chose…
– Oui, Guillaume…
– Pourquoi ne pas faire éditer tes musiques d’église ?
– Mais pourquoi donc ? Je les ai toutes classées et celui qui voudra les retrouver pourra le faire sans problème.
– Mais je pense en particulier à ta messe… Finis-la.
– Toi aussi ?
Je fus frappé de cette coïncidence, Anna Amélie et mon fils m’avait dit pratiquement la même chose…
Je retrouvai Leipzig avec la maison, l’école, mais surtout ma table de travail : j’avais en perspective du travail comme rarement au cours de ma vie. Composer cette Offrande Musicale au roi de Prusse, finir mon cahier de contrepoint et de fugues, réfléchir aussi à cette messe que j’avais décidé de construire…
J’avais déjà conçu pendant le voyage le plan de l’Offrande Musicale. Il y aurait trois parties : une partie de virtuosité au clavier et dans le contrepoint (celle que le roi avait recherchée en me faisant venir), une partie divertissement (dont le roi me croyait sans doute incapable), une partie technique (dont le roi ignorait sans doute la rigueur de construction). Avec Guillaume, nous avions trouvé un jeu de mot pour donner un nom à ces fugues à partir des lettres R I C E R C A R qui avaient plusieurs sens: c’était un mot italien évoquant une ancienne forme musicale et qui voulait dire « cherchez et recherchez ». Nous lui avions donné un autre sens pour le roi qu’on peut traduire par le jeu de mots : « Roi Injonction Chant Et Reste Canons Artistement Résolus ».
Tout cela ressemblait à un discours de rhétorique avec un plan précis comme celui d’un orateur romain : la virtuosité ce seraient les fugues, (celle que j’avais improvisé et une autre à six voix que j’avais refusé de tenter devant le roi), le divertissement serait une sonate pour flûte (injouable pour le roi, car trop difficile pour un amateur comme lui), et la technique ce seraient des canons (seul les connaisseurs pourraient apprécier).
Le Roi n’avait vu en moi que le virtuose : il n’avait pressé qu’un petit tiers du citron !
Pendant que je travaillai à l’Offrande Musicale, c’était au mois de juin 1747, j’eus la visite d’un de mes anciens élèves qui s’appelait Laurent Mizler : c’était un jeune homme charmant, docteur en médecine, qui se voulait homme de grande culture. C’est pourquoi il avait fondé une société de prétendus savants comme il y en avait tant: chaque membre devait avoir des connaissances en mathématiques et en philosophie et présenter chaque année une œuvre théorique ou pratique sur la musique.
– Bonjour Mizler !
– Bonjour, Maître, je suis en voyage et je suis passé par ici : je viens d’Erfurt où j’ai fait ma médecine je vais à Varsovie où je compte m’établir.
– Mais ce n’est pas du tout le chemin !
– J’ai fait un petit détour spécialement pour vous voir. Comment vous portez vous après votre voyage à Berlin ?
– Mais très bien, voyons. Vous voyez, je suis en train de travailler sur une des fugues dont le thème m’a été donné par le roi de Prusse.
– Puis-je regarder, Maître ?
– Mais bien sûr ! Je vais faire graver cela sur cuivre pour le faire imprimer… Mais Mizler, euh… puisque vous êtes médecin je voudrais avoir votre avis. Voilà : pour voir de près, j’utilise des loupes et des verres de plus en plus gros, et puis j’ai souvent l’impression de voir à travers un vitrail ou une sorte de brume. Est-ce que vous croyez que c’est, comme on me dit parfois, parce que, depuis que je suis tout jeune, je travaille si souvent et si intensément sur mes partitions ?
– Mais pas le moins du monde. Simplement, vous n’avez plus vingt ans.
– Savez-vous que j’ai dépassé les soixante ans ?
– Vous ne les paraissez pas, Maître.
– Avec une perruque, vous savez, on cache bien des choses. Oh ! cela ne m’empêche pas de travailler mais il me faut de plus en plus de chandelles pour m’éclairer et cela coûte cher la lumière, vous savez, Mizler. Ah ! Autre chose, vous qui parcourez le monde, venez, approchez-vous : voilà, je voudrais acheter une action dans une mine à Voigtberg, vous croyez que c’est bon ?
– Je pourrai me renseigner si vous le souhaitez.
– N’oubliez pas, hein ? Et votre société de savants, qu’est-ce qu’elle devient ?
– Elle attend que vous en deveniez membre, Maître.
– Oui, je sais mais j’hésite toujours. Regardez là j’ai même fait faire ce portrait de moi par Haussmann… au cas où je me décide.
Je pris le teableau et le posai de façon à ce qu’il soit bien éclairé.
- Vous voyez la feuille que je tiens à la main sur le tableau : c’est un canon.
Ce sera ma première contribution à votre société…si j’y entre. Maintenant regardez ce papier : c’est celui que je tiens à la main sur le tableau d’Hausmann. Venez, vous allez être le premier…
Je me mis devant le clavicorde :
– Écoutez…
Je lui jouai le canon… On pouvait superposer les voix jusqu’à 6 fois, en les décalant à chaque fois de quelques notes.
– Maintenant je mets le papier dans l’autre sens, le haut en bas. Tenez, jouez vous-même !
Étonné, il se mit à jouer :
– Cela sonne autrement mais c’est bien agréable aussi.
– Maintenant Mizler, je mets le papier devant la fenêtre, je le retourne, vous voyez par transparence ?
– Oui !
– Eh bien, jouez maintenant.
– Mais c’est incroyable, Maître et en plus cela sonne encore bien !
– Merci pour le compliment Mizler ! Moi voyez-vous, ce que j’aime dans celui-là, c’est qu’il se transforme presque en bruit, on est à la limite entre la musique et le bruit. Plus tard, peut-être fera t’on du bruit au lieu de faire de la musique !… Euh… Ah oui ! Combien faut-il payer pour être membre de votre société ?
– Environ 1 000 F par an. Vous seriez le 14ème (14 c’est votre chiffre), tout de suite après Haendel et Graun qui se sont inscrit !
– Haendel ? Et Graun aussi ? mais je l’ai vu à Berlin, il ne m’en a pas parlé. Telemann en est aussi, je crois.
– Oui.
– Il n’y a pas de réunions ?
– Non, ce sont des envois de documents, c’est cela qui coûte cher ! Il s’agit d’inscrire la musique dans le grand mouvement actuel des connaissances humaines.
– Eh bien, vous ne manquez pas de prétention ! Expliquez-moi alors comment il se fait que la nouvelle musique n’ait rien de scientifique comme vous dites. Moi, avec mes canons et mes fugues, j’ai l’impression d’être beaucoup plus scientifique que mes fils, par exemple.
– Mais justement, Maître, cette mode ne peut être que momentanée. Moi, je pense qu’il faut maintenir la musique au carrefour des Sciences et de la Beauté.
– Oui, mais moi, je n’écris pas de mots, comme tous vos membres. Et puis ce ne sont pas les sciences elles-mêmes qui m’intéressent, c’est la façon dont elles peuvent contribuer à me faire faire de la belle musique ! J’écris de la musique, pas des mathématiques ou de la philosophie, vous comprenez cela ?
– Telemann et Haendel font de même.
– Eh bien Mizler, Vous m’avez convaincu : je vous annonce que je suis des vôtres !
Le brave Mizler était tout heureux !
– Et vous aurez droit à une histoire de votre vie à votre mort…
Il devint tout rouge et je lui souris en lui prenant doucement le bras. Puis il redevint sérieux.
– Maître vous avez un devoir envers notre société et envers vous-même : faites en sorte que vos œuvres puissent rester. Faites les graver sur cuivre par exemple. Je le dis à tous nos membres compositeurs mais particulièrement à vous.
La discussion se poursuivit longtemps sur les sciences, la musique, les mérites des auteurs latins…
Je travaillai si intensément sur ce que j’appelais le Thème du roi (celui de l’Offrande musicale) qu’Anne s’en inquiétait.
– Tu ne t’arrêteras donc jamais. Fais donc attention à tes yeux.
– Je ne vois pas pourquoi travailler m’abîmerait les yeux ?
– Pourquoi ne pas me dicter ce que tu as en tête plutôt que de l’écrire ?
– Mais non, petite maman, je te le dirais si j’en ai besoin, comme je le fais toujours.
Et, après à peine deux mois, j’avais fini mon Offrande Musicale: début Juillet 1747, je la faisais parvenir au Roi de Prusse avec une belle dédicace en allemand. Je n'avais personne pour l'écrire en français, comme celle des 6 concerts pour la margrave de Brandebourg: d'ailleurs je n'en avais pas tellement envie.
Chaque jour, désormais, je travaillais à ma grande messe : ses proportions, sa construction, m’apparaissaient clairement. Je prendrais le temps de construire une cathédrale, comme disait mon cousin « panier percé ». Je cherchais dans mon œuvre passée les matériaux nécessaires à cette construction.
Mes fonctions de directeur de la musique de Leipzig m’occupaient toujours beaucoup. Görner et moi étions maintenant au mieux depuis que nous supervisions ensemble la réparation de l’orgue de l’église de Saint Thomas.
Mes deux derniers fils étaient presque de jeunes hommes. Frédéric avait déjà 16 ans. Il était toujours aussi bon virtuose et toujours aussi sage. Son jeune frère Jean-Chrétien était plus turbulent, mais rien à voir avec son défunt demi-frère Bernard. Il serait toujours comme un oiseau sur la branche, une vraie tête de linotte. Cela se ressentait dans son jeu.
Un exemple entre autres : il m’arrivait maintenant de me coucher plus tôt, avant que mes grands enfants ne s’endorment. Je leur demandai alors de me jouer du clavecin. Un jour Jean-Chrétien, croyant que je dormais, s’arrêta au milieu d’une improvisation sans finir un accord. Je bondis de mon lit et lui flanquais une de ces gifles dont j’avais le secret et terminai le morceau moi-même pendant qu’il se mettait à pleurnicher. Mais j’aimais bien ce petit garçon, il avait souvent les mêmes mimiques qu’Anne et cela me ravissait: après tout, il était mon petit dernier. Je lui promis un jour en plaisantant qu’à ma mort, il aurait mes clavecins.
Anne éprouva un grand bonheur quand elle apprit qu’Emmanuel lui demandait d’être marraine de mon deuxième petit fils. Elle qui avait toujours craint de ne pas être à la hauteur de sa tâche de mère pour soigner mes enfants de ma première femme, en éprouva un grand réconfort.
Un autre bonheur nous arriva, à moi et à Anne, bonheur que nous pressentions depuis quelque temps. Nous nous plaisions à observer les regards que se jetaient parfois notre fille Liesgen, et mon élève Altnickol, qui depuis quelque temps était payé en tant que choriste (voix de basse) à Saint Thomas. Ils nous annoncèrent un jour leur intention de partager leur vie, en respectant bien toutes les formes de la bienséance et de la religion. J’obtins d’ailleurs pour Altnickol quelques mois plus tard le poste d’organiste de ce splendide orgue de Naumberg que j’avais expertisé avec Silbermann.
Après l'Offrande, je pouvais maintenant reprendre le cours de mon travail : finalement cette société Mizler tombait bien, j’allais chaque année devoir produire pour elle une œuvre nouvelle. J’avais l’impression d’être revenu aux premiers temps de Leipzig, quand je faisais chaque semaine une musique nouvelle !
Chaque jour, je travaillais à ma grand messe.
Les chœurs et les airs s’y succédaient : certains étaient des œuvres anciennes et d’autres étaient totalement nouvelles. Je pensais ainsi que ma messe était comme une cathédrale qui se construit aussi bien avec des pierres neuves qu’avec des pierres anciennes. Je relus beaucoup des musiciens comme Palestrina, Pergolèse ou Lotti où je trouvai des idées bouleversantes. J’étais saisi moi-même de la beauté de ce que le Seigneur m’inspirait.
Je feuilletai souvent mes anciennes partitions. Il me vint à l’idée de reprendre mes six sonates pour orgue et je me mis aussi à retoucher des chorals que j’avais composé à Weimar. Contrairement à ma musique de chambre, j’avais conservé toutes mes œuvres pour orgue et mes musiques d’église… Parmi les chorals composés à Weimar, j’en retins une quinzaine. J’y apportai de légères modifications.
Après plus de 30 ans, j’étais heureux de constater que je restais fidèle à mon inspiration première…
Je m’aperçus toutefois que les voix qui accompagnaient ces chorals n’étaient pratiquement jamais des canons parfaits. Je décidai donc de prendre un thème de choral de Noël et de construire au-dessus de ce thème des canons parfaits : démonstration que la qualité technique n’est pas incompatible avec la profondeur de l’œuvre mais au contraire la rend plus riche et plus belle. Cela serait un apport utile à la société de Mizler. J’éprouvais en composant ces canons un sentiment de joie et de satisfaction. Je trouvais des solutions agréables à l’oreille à ce qui paraissait déjà un tour de force technique aux meilleurs musiciens.
Il paraît que les mathématiciens éprouvent les mêmes sentiments quand ils trouvent des solutions qu’ils apellent « élégantes ». Il faut donc croire que j’ai aussi un esprit mathématique.
Cependant, chaque jour ma grand messe se construisait. J’aimais bien avoir à l’esprit cette image des pierres neuves et anciennes.
Les pierres neuves étaient certains airs et certains chœurs, en particulier dans le Credo. Pour ce Credo, j’avais choisi de prendre le texte du symbole de Nicée, la prière universelle de tous les Chrétiens.
Les pierres anciennes, je les reprenais dans des musiques déjà composées : ainsi le Kyrie et le Gloria offerts au Prince de Dresde. Pour les autres parties, je choisissais mes « pierres anciennes » parmi mes musiques d’église qui me menaient le plus près de mon Sauveur. Je les modifiais parfois pour les adapter aux textes de la messe.
L’édifice allait former un tout, se dresser vers le ciel comme la cathédrale de Lübeck. Qui se préoccupe de la date de la construction de telle ou telle partie d’une église, si elle est belle et si elle vous mène vers le Seigneur ?
Pour le reste, je n’en dirai pas plus : écoutez simplement ces musiques… seule la musique pourra pénétrer votre âme de cette façon.
J’avais aussi en tête mon cahier d’exercice de contrepoint et de fugues. Autour de moi on appelait déjà l’Art de la Fugue. Ce titre était faux car je voulais y mettre aussi, tout comme dans mes cahiers précédents, des canons ou autres formes de contrepoint. Finalement j’avais prévu que ce cahier comprendrait 24 pièces, les premières ayant déjà été composées depuis 7 ou 8 ans déjà. Je les avais mises dans un ordre qui tenait compte de leur rapport entre elles et de leur complexité croissante. Je travaillais avec Schübler pour les faire graver sur cuivre. Déjà j’avais les dernières pièces en tête et je les avais même recopiées sur le papier sous forme de brouillons sur deux portées : je me souviens justement de l’un de ces brouillons que je n’avais pas pu finir car ma plume à cinq becs m’avait échappé des doigts, rendant les portées inutilisables. C’était le brouillon d’une fugue avec les quatre notes B A C H (si bémol, la, do, si) comme troisième thème, ajoutant ainsi un nouveau symbole à découvrir par ceux, s’ils devaient un jour exister, qui aimeraient retrouver des symboles dans ma musique.
Je travaillais toujours à bâtir ma grande messe.
Je devais bien constater que le voile devant mes yeux s’épaississait et ne me facilitait pas le travail. Notre maman avait du mal à cacher sa peine et son inquiétude devant l’état de ma vue: elle avait près de 50 ans maintenant. Heureusement, pour m’aider, j’avais près de moi des amis fidèles : mon cher copiste Vr prenait beaucoup sous ma dictée et continue à le faire aujourd’hui encore. Mon futur gendre m’aidait aussi avec une constante gentillesse. Catherine, ma fille aînée, était toujours aussi gaie et vaillante. Je pouvais donc continuer à travailler presque normalement.
Je dois dire aussi que les gens de l’extérieur qui faisaient les choses mal ou incomplètement avaient de plus en plus le don de m’horripiler.
Ainsi un aubergiste qui tardait à me rendre un clavecin eut droit à une lettre plutôt salée.
Il en fut de même pour ce brave cousin Jean-Elias qui en son temps avait éduqué certains de mes enfants. Il m’écrivit une lettre ampoulée pour me demander un exemplaire d’une partie de mon Offrande Musicale et je lui répondis :
"Le temps me manquant je vous dirai beaucoup de choses en peu de mots…au sujet de l’exemplaire…que vous me réclamez, je ne puis vous donner satisfaction… car l’édition s’en trouve justement aujourd’hui épuisée…(seulement cent exemplaires ont été imprimés dont la plupart ont été offerts gratis à de bons amis). J’en ferai tirer quelques autres d’ici à la Foire de la nouvelle année; si monsieur le cousin a encore l’intention d’en avoir un exemplaire… il lui suffira de m’en faire part à l’occasion et de m’envoye un thaler (500 F) et ce qui est réclamé arrivera.."
Le pauvre garçon m’envoya aussi un jour un tonneau de cidre qui m’arriva aux trois quarts vide. Je lui répondis, en novembre 1748 par une lettre que, pour une fois, j’écrivis moi-même..
"Il est extrêmement regrettable que ce petit fut ait souffert soit à cause des cahots de la route soit pour toute autre raison".
Et en post scriptum, j’ajoutais
"Bien que mon cousin se soit offert à envoyer de la même liqueur… il faut l’en dissuader… chaque mesure me revient à 5 groschen (100 F) ce qui pour un cadeau est bien trop cher".
Je lui fis également comprendre dans la même lettre que je ne souhaitais pas trop qu’il vienne au mariage de ma fille
"L’éloignement aussi bien que la mauvaise saison ne permettront sûrement pas de voir chez nous monsieur le Cousin en personne".
Le mariage de « Liesgen » (Elizabeth) avec mon élève Altnickol eut lieu le 20 Janvier 1749. Ce fut une fête merveilleuse. Les jeunes époux étaient radieux : elle avait 23 ans et lui 29. Guillaume et Emmanuel avaient pu venir ainsi que des membres du conseil municipal de Naumburg, et de nombreux amis de Leipzig et de Dresde. Notre maison était bondée et nous avions dû empiéter sur l’école pour réunir tout le monde à l’intérieur car il faisait très froid. Mais le plus beau cadeau, c’est peut-être moi qui le reçus en écoutant ma femme, mes enfants, nos amis, et moi-même bien sûr aussi, faire tous ensemble une orgie de musique. Quel autre art pourrait donner autant de joie à la fois à ceux qui le pratiquent ensemble et à ceux qui l’entendent ensemble ? N’avais-je pas négligé ces derniers temps cet aspect de mon art ?
Non, puisque chaque jour je continuais à bâtir ma grand messe.
À la fin de ces noces, je ressentis quelques vertiges et une sorte d’oppression dans la poitrine que je n’avais jamais connus auparavant. Anne s’en alarma et me supplia de me reposer : je ne pouvais rien contre elle quand elle prenait ce sourire inquiet et suppliant. Je m’endormis… Je fus réveillé au milieu d’un rêve où m’apparaissait Anna Amalia : elle avait l’air d’un ange et me parlait de ma messe en chantant.
Je sortis peu à peu de ma torpeur : en réalité c’était Anne qui chantait doucement en s’accompagnant au clavicorde. Ce réveil se fit dans un doux apaisement. Cet air que chantait Anne serait une nouvelle pierre pour ma grand messe.
Jusqu’à cette page j’ai tenu à rédiger moi-même les textes qui précèdent. N’étant pas particulièrement doué pour les mots, je tiens à faire part à mes lecteurs de mon regret d’avoir si mal écrit et si mal raconté. Mais j’ai pour moi la sincérité.
Ma vue baissant, je préfère garder mes capacités d’écriture pour la musique.
Les textes qui suivent seront donc dictés, en particulier à Vr, à mon épouse Anne, à mes fils, à mon élève Müthel et à d’autres. Il est bien probable que je ne pourrai pas les relire.
Je me souviens en particulier d’une scène parmi d’autres. C’était à Pâques 1739 : j’avais choisi de jouer une passion que j’avais déjà dirigée plusieurs fois. Mais ces messieurs avaient décidé de m’agacer et il y réussirent fort bien. Il m’envoyèrent huit jours avant un sous-greffier, répondant (ça ne s’invente pas) au nom de « Croquemort d’Abeille ». Il sonna. Jean-Elias alla lui ouvrir. J’entendis :
– Est-ce bien ici qu’habite monsieur Bach ?
– Mais oui, bien sûr, voyons.
– J’ai un message du très sage Conseil pour lui.
– Donnez-le moi.
– Non, je dois lui délivrer oralement.
Je criai :
– Fais-le monter !
Le jeune sous-greffier monta lentement, s’arrêta devant la porte, il était vêtu tout de noir :
– Entrez donc, jeune homme.
Il avait un papier à la main
– Monsieur Bach…
– Oui, ah mais nous nous connaissons je crois, dis-je sans lever la tête.
– Le très sage Conseil…
– Qu’est-ce qu’il me veut, le très sage Conseil ?
– Le très sage Conseil…
– Vous l’avez déjà dit.
– Me charge de vous dire…
– Quoi ? allons vite, mon garçon : vous voyez bien que je suis fort occupé. Je travaille pour ceux qui vous envoient : je mets la dernière main à la Passion de la semaine prochaine…
– C’est-à-dire que justement…
– Qu’y a t’il encore ? Allons lisez-moi votre papier, dis-je en levant enfin la tête vers lui.
Le jeune homme en noir lut d’un trait :
– La musique que vous avez prévue pour le prochain vendredi saint ne devra pas avoir lieu tant que vous n’aurez pas reçu l’autorisation ordinaire.
Puis il baissa les yeux.
– Jeune homme, regardez-moi. Retenez bien ceci et allez le répéter à ceux qui vous envoient, mot à mot, vous m’entendez mot à mot : c’est votre métier de répéter. Dites-leur ceci : « C’est à chaque fois la même chose: on m’interdit. Je ne demanderai aucune autorisation, d’ailleurs cette autorisation, je n’en ai rien à… faire, ce ne sont que des simagrées. Je vais rendre compte au surintendant de cette interdiction". Attendez, dites leur aussi ceci: "Si c’est en pensant aux textes que cela est fait, ces textes ont déjà été chantés plusieurs fois". Dites-leur bien cela. Maintenant laissez-moi travailler et allez au diable.
Le jeune homme restait là, figé.
– Allez ouste, jeune homme, vous avez entendu ? Je travaille, moi et quand je dis quelque chose, je sais de quoi je parle.
Le jeune sous-greffier descendit l’escalier beaucoup plus vite qu’il ne l’avait monté.
Restait l’essentiel, qui d’ailleurs pourrait contribuer à combler les insuffisances désormais flagrantes du chœur de l’école: Ernesti en était un des grands responsables. L’essentiel, c’était mon grand projet de musique pour orgue, ce que j’appelais le troisième cahier d’exercice. Je voulais le terminer pour Pâques mais je ne fus pas prêt : j’avais tant à faire et puis il y avait des problèmes d’imprimerie. Il y avait surtout ma volonté de construire un édifice musical audacieux dans ses dimensions et dont chaque pièce soit parfaite dans sa forme.
La création de cette œuvre m’aida à supporter deux nouvelles bien pénibles pour moi. La première fut l’annonce de la mort de mon cher Jean-Ernest, le fils de la Tante Marthe et du frère jumeau de mon père. Avec lui j’avais partagé une partie de mon enfance à Arnstadt, puis au lycée d’Ohrdruf, puis à Hambourg et il m’avait remplacé à Arnstadt. Grâce à lui j’avais connu le grand Buxtehude. Il paraît qu’il était mort aveugle. La seconde nouvelle pénible fut la disparition sans espoir de retour de notre cher fils Bernard : je priai Dieu pour qu’il le prenne en son sein quand il paraitrait devant lui.
Quand Guillaume vint en Juillet 1739 avec des amis musiciens, la plus grande partie du troisième cahier était terminée. Je le lui montrai :
– Père, la dernière fois que tu m’as montré une œuvre, c’était devant Keyserlingk, le concerto italien, si gai, si profane. Et maintenant, ce monument religieux !
– J’ai peur pour notre religion, mon fils !
– Tu sais, ce n’est pas parce que la Raison…
– Oui, je sais, mais ta Raison ne peut expliquer tous ces symboles religieux qui sont autant de marches et d’indications que Dieu nous révèle dans les livres Saints et que les écrits de Luther nous font si bien comprendre.
– Écoute, regarde, père, dis-toi que les mathématiques ne sont que des symboles eux aussi. Leibniz parle aussi bien des miroirs que du calcul infinitésimal.
– J’ai beaucoup réfléchi à ce fameux calcul infinitésimal. C’est un peu comme si, au bout de l’infini, nous trouvions une nouvel ordre : Dieu par exemple ?
– On peut le comprendre comme ça, oui pourquoi pas ? Les mathématiques, comme la religion expliquent l’inexplicable.
– Si tu mets face à face deux miroirs, tu as aussi des reflets à l’infini, c’est ce que nous faisons en musique avec des canons et les fugues qui peuvent être en miroir, en mouvement contraire, renversé, rétrograde, composé, circulaires, en augmentation, en diminution et même perpétuels
– Tu oublies ceux qui sont « à l’écrevisse ».
– Non je n’oublie pas… mais cela sonne mal à l’oreille... Oui, mon fils, tu as raison, tous ces mécanismes, comme ceux des mathématiques sont pleins de mystère…
Je restai silencieux un instant.
– Tiens à propos de mécanisme, je voudrais te montrer mon nouveau clavicorde regarde…
Je lui montrai une modification que j’avais bricolée moi-même avec quelques outils et qui permettait d’améliorer la sonorité de mon clavier-luth.
– Tu vois je peux jouer piano ou forte selon les passages de ce prélude. Il suffit de glisser cette petite barrette près des cordes. Écoute…
– Et je lui jouai un prélude.
– Mais père, tu es un vrai professionnel, tu pourrais inventer et fabriquer des instruments toi-même comme certains de nos cousins.
– Le temps me manque, mon fils.
Quand Guillaume repartait, quelque chose de moi s’en allait avec lui.
Je marchai chaque jour beaucoup pour aller d’un point de la ville à l’autre. Parfois je regardai tout autour de moi les gens, les marchands, (tout ce peuple de tailleurs, savetiers, tailleurs de pierre, charpentiers, cuisiniers, sommeliers comme disait Luther) les libraires, les enfants, les paysans, les bourgeois, les ouvriers, les notables. Certains marchaient comme moi en silence, d’autres criaient, couraient, s’affairaient, chantaient parfois, d’autres encore circulaient à cheval ou dans des carrosses, malgré l’étroitesse des rues.
Mais il m’arrivait aussi d’être si absorbé que je ne me rendais plus compte de ce qui ce passait autour de moi: mon esprit était immergé dans des musiques. Ce jour-là, je pensai à la conversation que j’avais eue avec mon fils à propos des miroirs, des canons et des mathématiques… Je ressentais plus fort que jamais en moi, cet attrait pour les chiffres et les symboles, qu’ils soient mathématiques ou non. Rappelez-vous, j’éprouvais cela depuis mon adolescence. Mon fils Emmanuel m’en avait même parfois fait le reproche. Cela venait du fonds de moi-même et de la foi que m’avait transmise mes ancêtres. Jamais des hommes au prétendu grand savoir comme Ernesti, Wolff et leurs comparses ne pourraient donner par tous leurs commentaires ne serait-ce qu’un début d’explication à la profondeur des textes et des symboles contenus dans les Écritures Saintes. Seule la musique, au delà des mots, peut tenter de rendre gloire à la suprême perfection, à la suprême complexité, à la suprême humilité, au suprême sacrifice de ce Dieu venu sauver le monde.
Mes réflexions furent brutalement interrompues par des appels venus de l’autre côté de la rue :
– Monsieur Bach, Monsieur Bach !
C’était mon ami Birnbaum qui continuait toujours, inlassablement, à écrire à ma place des textes qui parlaient de moi et de des qualités de ma musique. Il brandissait à la main des gazettes en m’appelant. Il parvint enfin jusqu’à moi:
– Regardez, regardez !
Et tout en marchant, il me montrait des articles. Lui, homme d’habitude si pondéré, je ne l’avais jamais vu dans un tel état ! Nous étions justement dans la rue de Catherine, celle du café Zimmermann.
– Écoutez, cher ami, restez calme, allons au café si vous le voulez bien !
Zimmermann nous accueillit lui-même.
– Alors, monsieur le Cantor, qu’est-ce que vous nous préparez pour vendredi ? Vous savez que tout le monde est content que vous ayez repris vos concerts ici.
Puis s’approchant tout près de moi :
– Vous savez, monsieur Bach, avec Monsieur Gerlach, ce n’était pas la même chose !
– Allons, Zimmermann, allons !
– Qu’est-ce que je vous sers ?
– Pour moi ce sera un petit vin blanc.
– Pour moi, dit Birnbaum, une tasse de café. Bach, tenez, lisez ceci :
Je pris la gazette, c’était le Musicien Critique, la Gazette où Scheibe m’avait tant critiqué :
– Je ne vais pas encore lire ce tas d’immondices.
– Lisez, lisez…
– Ce concerto pour clavier doit être regardé comme le parfait modèle du concerto à une voix. Forcément dès qu’il y a deux voix, il est perdu, ce jeune Scheibe !
– Attendez, ce n’est pas fini ! C’est de votre concerto italien qu’il parle ! "Seul un aussi grand maître de la musique que Monsieur Bach pouvait nous donner une telle œuvre que les étrangers ne pourront chercher à imiter qu’en vain."
- Excessif, ce jeune homme, il change comme une girouette. Quant aux étrangers, bien souvent ce sont nos modèles.
– Allons ne boudez pas votre revanche.
– C’est vrai, Birnbaum, mais il doit y avoir de son ami Mattheson, là-dessous. Celui-là, il voit que je suis célèbre, alors il veut être bien avec moi !
– Vous ne croyez pas si bien dire ! Vous savez qu’il vient de publier une collection de fugues ? Regardez ce qu’il a écrit dans « Le parfait Maître de Chapelle »: "J’aimerais voir quelque chose de cette manière publié par Monsieur Bach de Leipzig, qui est un grand maître de la fugue…"
– Que veut-il dire ?
Je quittai Birnbaum et continuai ma marche et ma réflexion. Tout à coup ma pensée chavira: la suprême perfection n’existe pas. La seule chose que nous pouvons faire, c’est essayer, toujours essayer de nous approcher de la perfection mais en étant sûrs de ne jamais l’attendre. Cela a un nom en mathématiques, Jean-Elias trouvera sûrement cela dans son Leibniz…
Bien sûr, je ferais mieux que Mathesson,. Mais comment ? Depuis ce jour je ne cessai de penser à un nouveau cahier d’exercice qui pourrait tourner autour de toutes les formes du contrepoint et en particulier de la fugue. Contrairement à d’habitude, je ne vis pas tout de suite la tournure que je donnerais à ce travail, mais peu à peu dans mon esprit se construisait une œuvre que personne ne pourrait jamais égaler.
Je rentrai et trouvai Jean-Elias qui, comme chaque soir, m’attendait. Il m’était d’un grand secours : il était devenu presque comme un domestique complaisant et fidèle et me rendait beaucoup de services dans beaucoup de domaines. Nous avions pris l’habitude de travailler le soir, quand toutes nos obligations de la journée avait été remplies. Dois-je l’avouer ? Il ne me déplaisait pas de le taquiner un peu, ce « jeune » universitaire de 33 ans.
– Alors Jean-Elias, qu’as-tu fait aujourd’hui ? Les enfants ?
– Je pense qu’ils sont prêts pour leur communion…
– Bien, et mes fils, qu’ont-ils appris ?
– Votre petit dernier Jean Chrétien est très éveillé pour son âge.
– Sais-tu, Jean-Elias, que moi aussi j’étais le petit dernier ?
– Nnnon je ne savais pas, mais chez vous, monsieur mon cousin, c’est votre fille Caroline qui est la petite dernière…
– Oui, si tu veux. Et Henri, qu’a-t-il fait aujourd’hui ?
– Eh bien, monsieur mon Cousin, votre aîné a toujours besoin d’un enseignement solide et fidèle… Nous nous entendons très bien… Quant à Frédéric, c’est un enfant modèle…
– Oui, c’est le plus grand virtuose de la famille, mais il est un peu… ennuyeux.
– Oh monsieu…
– Ne dis surtout pas cela à sa mère… Mais jamais il n’aura ce grain de folie qu’ont tous mes autres fils, et moi-même aussi d’ailleurs : c’est cela qui nous fait sortir du lot innombrable des musiciens ordinaires…
Je restai un moment dans un silence que Jean-Elias sut respecter.
– Ah dis moi et ces œillets ? Ma femme m’en parle tous les jours. Il faut les planter maintenant, tu le sais !
– Mais, monsieur mon cousin, j’ai déjà écrit plusieurs fois.
– Sais-tu qu’il y en a des jaunes et des bleus ?
– Ah bon, parce notre maman en voudrait aussi des bleus… Je vais écrire à nouveau…
– Tu sais que j’aimerais bien connaître ta ville de Schweinfurt. Mais là-bas au sud, au delà de ma forêt de Thuringe, cela me semble bien loin.
– C’est un beau pays, monsieur mon cousin, où il fait bon vivre. Et puis c’est de là que viennent les bons vins doux de Franconie et notre bonne eau de vie.
– Ils sont aussi bons que les vins qu’on boit ici ? Crois-tu qu’ici ils plairaient ?
Jean-Elias avait enfin compris car il me répondit :
– Monsieur mon cousin, accepteriez-vous, que, pour vous montrer ma reconnaissance, j’en fasse venir quelques mesures ici ? Je vais écrire… Car si je pars bientôt…
– Partir, bientôt, toi ? Mais il n’en est pas question, Jean-Elias, ce n’est pas possible. Tu as la responsabilité de mes enfants, tu me rends beaucoup de services pour les écritures, tu fais partie de la famille… et puis tu as un contrat de trois mois.
Jean-Elias semblait hésitant, comme s’il voulait me dire quelque chose, puis sembla y renoncer. Je n’avais aucune envie qu’il continue à me parler de son départ.
– Au fait qu’as-tu trouvé d’intéressant dans les librairies ?
– Je trouve beaucoup de choses dans les catalogues, en particulier celui de Rüdiger, mais les livres sont chers.
Jean-Elias consultait beaucoup Rüdiger, car ce catalogue était gratuit.
– Bien, nous allons travailler maintenant. Apporte-moi, la partition qui est là-bas sur l’étagère.
– Voici…
– C’est la cantate qui commence par : « J’en ai assez ».
Je vais te demander de copier… Eh bien tu vois, là… mais on n’y vois rien ici, il faut changer de chandelle. Apporte m’en une autre…
– Mais c’est la même que d’habitude…
– Apporte m’en une autre, te dis-je…
Avec deux chandelles je pus lire la partition. Cela me surprit un peu mais je n’y pris pas garde…
– Bon maintenant, je vais te dicter une lettre… Ensuite tu iras la porter à…
– Mais vous savez bien, monsieur mon cousin, que je ne peux pas faire une lettre directement comme cela. Il faut que je fasse un brouillon avant…
Jean-Elias avait la manie de faire des brouillons. Moi je trouvais que cela gâchait du papier et du temps. Mais il les rédigeait dans un cahier « pour avoir des traces » disait-il.
– Bon c’est une lettre pour ton ami Koch, Cantor à Ronneburg. Quand il est venu ici prendre des cours avec moi…
– Je vous remercie, monsieur mon cousin d’avoir accepté d’accueillir cet ami si…
– C’est très gentil à lui de m’avoir fait parrain de sa fille et de m’avoir invité au baptème. Mais tu vois que je suis débordé. J’ai dû aller à Altenburg pour cet orgue… D’ailleurs le site est splendide, le château et la chapelle sont construits sur le flanc d’une colline abrupt…
– Pourtant Altenburg est à quelques kilomètres de Ronneburg dans la même direction et le baptême était trois jours après votre concert: tout était combiné…
– Des reproches, Jean-Elias ?
– Non, non, pas du tout, monsieur mon Cousin, d’ailleurs ils ne vous en veulent pas puisqu’ils vous ont envoyé une partie de ce qui restait…
– C’était très bon d’ailleurs. Bien ! Dans ta lettre dis leur bien que j’exprime à Monsieur le Cantor et à Madame son épouse, outre mes sentiments les plus dévoués, « mes » remerciements pour les beaux morceaux de la cérémonie qui ont été consommés à leur santé.
– Attendez, vous allez trop vite !
– Dis leur aussi que je suis débordé, que je recommence mon Collegium Musicum et que je vais jouer pour l’anniversaire…
– Je ne suis pas, monsieur mon cousin, vous allez trop vite…
– …du Roi et que j’aimerais qu’il vienne, lui, ici…
Quand notre travail se prolongeait, le visage d’Anne, notre maman, apparaissait, au bord de la porte, et elle nous regardait en souriant, sans rien dire, comme si elle ne voulait pas gêner. Ce sourire avait le don de me faire fondre de tendresse. Même si l’âge commençait à laisser des traces sur son visage et sur son corps, elle restait pour moi cette jeune fille espiègle et sérieuse, bonne chanteuse et bonne musicienne, qui faisait ma joie.
– Qu’y a t’il, notre maman, tu parais impatiente de nous parler.
– Vous avez bientôt fini votre travail ? Eh bien oui, je suis impatiente: car on m’a parlé d’un oiseau qui chante !
– Un oiseau ?
– Mais oui, il paraît qu’il y en a un qui s’appelle la linotte mélodieuse et qu’on peut mettre en cage. Et on peut lui apprendre à chanter. Comme j'aimerais en avoir un! Allons, venez vite, les deux travailleurs !
Elle quitta la pièce puis revint :
– À propos, Jean-Elias, as-tu des nouvelles de mes œillets ?
Jean-Elias eut l’air consterné. Et elle redescendit enfin.
Jean-Elias et moi nous retrouvions seuls.
– Jean-Elias !
– Oui ?
– Pour l’oiseau, rien ne presse…
– L’oiseau ?
– Oui, cette linotte mélodieuse.
– Ah oui !
– Mais bien sûr, si par le plus grand des hasards, on t’en propose un, accepte-le: mais nous nous arrangerons pour qu’il soit mis assez loin de ce cabinet de travail…
Pour la première fois depuis le début de notre séance de travail, je vis Jean-Elias sourire : il avait compris.
Quelques temps après, je pus enfin avoir à Leipzig le jeune Goldberg comme élève. Il était venu de Dresde avec Guillaume et le Baron. Il s’avéra un élève remarquable.
Je lui apprenais la théorie de la musique avec d’autres élèves au premier étage dans mon cabinet de travail. Un soir, comme nous descendions, j’entendis Anne qui jouait un air que j’avais composé en prenant une basse de quelques notes formant une cadence très simple. Elle l’avait recopié dans son petit livre à couverture verte. Guillaume sursauta. En le voyant, notre maman s’arrêta. Je n’eus pas le temps d’intervenir: il s’assit à sa place devant le clavecin et, reprenant la même basse, improvisa sur le mode mineur une pièce d’une telle profondeur que tout le monde en fut fort ému. Je croyais que seuls les Italiens ou les Français étaient capables… Je fis un signe et je pris sa place : toujours sur le même thème je me mis à jouer à la façon de Domenico Scarlatti. Ces Scarlatti étaient un peu les Bach de l’Italie, une grande famille de musiciens. Ce Domenico avait publié deux ans auparavant une série de pièces pour clavecin tout à fait remarquables.
Je m’arrêtai puis demandai à chacun des élèves qui étaient là d’improviser un canon sur ce thème.
– Écoutez, voilà ce que nous allons faire : toi Agricola, tu vas faire un canon avec la deuxième voix démarrant à l’unisson. Toi, Kirnberger, dans le canon que tu vas improviser, la deuxième voix devra démarrer un ton au dessus. Toi, Agricola, une tierce et ainsi de suite. Vous avez un quart d’heure pour construire cela dans vos têtes et me le jouer après.
Frédéric s’était approché :
– Je peux jouer aussi ?
– Et moi ? dit le cousin d’Eisenach.
– Bien sûr !
– Et moi ? dit ma fille Liesgen.
– Essaie, on verra bien ce qu’une femme peut faire !
Elle me regarda avec un air de reproche, puis rougit et me dit :
– Ce n’est pas ce que tu dis de la Faustina, Père.
Je préférai sourire de l’effronterie de cette petite fille de 15 ans.
Ensuite chacun joua selon sa manière : ce fut très réussi.
Alors Henri s’avança : pour une fois il souriait mais avec malice, il s’assit au clavecin. À notre stupéfaction, il se mit à chanter une chanson :
– « Cela fait si longtemps que je ne suis près de toi : viens plus près, viens plus près ».
Et pendant qu’il chantait, il se mit à jouer les notes de basse : cela collait parfaitement. Alors nous fîmes tous cercle autour de lui, et je fis signe à notre maman de s’approcher de moi. Une idée m’était venue et sur ce que faisais Henri, je me mis à chanter une autre chanson :
– « Choux et raves m’ont fait fuir : si ma mère avait cuit de la viande, je serais resté plus longtemps ».
Les deux chansons et le thème de basse allaient tous trois très bien ensemble !
Dans la joie et la gaieté, nous nous sommes tous mis à chanter : mes enfants, notre maman, mes élèves préférés, tous étaient arrivés. Exactement comme autrefois dans nos réunions de famille. La soirée fut longue et joyeuse.
Au moment ou nous allions nous quitter, Goldberg s’approcha de moi.
– Maître !
– Oui, mon petit Goldberg, qu’y a t’il ?
– Vous savez que le Baron me demande de jouer du clavecin quand il somnole. Je crois que si vous pouviez écrire quelque chose comme ce que nous venons de faire…
Je fus tout à coup transporté hors du temps: des variations libres sur un seul thème et dans un seul ton, mais formant un œuvre pleine de variété, présentant tous les styles, tous les genres, avec de multiples correspondances de chiffres et de symboles, avec des canons, des fugues, des chansons, des… Il en faudrait beaucoup, peut-être
– Une pour chaque jour du mois
Je m’étais mis à parler tout haut sans m’en rendre compte.
– Qu’y a t’il, Sébastien ?
– Qu’y a t’il, papa ?
– Qu’y a t’il, maître ?
– Euh… je pensais à ton maître, mon petit Goldberg, une variation par jour du mois pour qu’il dorme, qu’en penses-tu ?
– Comment ! Trente variations sur un même thème, mais cela ne s’est jamais fait !
– C’est bien pour cela que je vais le faire !
Tous les regards convergeaient sur moi. J’étais heureux.
Seule ombre au tableau : Emmanuel n’était pas avec nous ce soir-là. Il était même très loin, quelque part au nord de Berlin, dans une petite ville appelée Rheinsberg. C’était là que vivait le fils de celle que j’avais rencontrée à Celle, dans ma jeunesse… Elle avait épousé le roi de Prusse, ce roi-sergent, plus large que haut, que j’avais aperçu quand j’étais allé chercher un clavecin à Berlin pour mon cher Prince de Cöthen. De ce roi-sergent elle avait eu un fils que son père avait exilé dans cette petite ville de Rheinsberg, dans un joli château tout entouré d’eau et de lacs. Ce fils était le petit Fritz qui m’avait vu, émerveillé par ma flûte et qui avait voulu essayer d’en jouer. Il était Prince héritier. Comme sa mère, il adorait la musique et la flûte : il en jouait comme un prince peut jouer de la flûte. Je crois que sa mère n’avait pas été étrangère au fait qu’il avait choisi Emmanuel pour l’accompagner au clavecin. La place d’Emmanuel était enviable car un jour ce prince deviendrait roi.
Et c’est effectivement ce qui arriva : le roi sergent mourut le dernier jour de mai 1740. Le jeune Fritz prit le nom de Frédéric II de Prusse et Emmanuel fut nommé claveciniste de la Chambre du roi. J’eus dès lors très envie d’aller le voir à Berlin. Mais c’était un long voyage et à cette époque, je voulais travailler à mes variations et à mon second volume du Clavier bien tempéré, sans compter ce cahier de fugues et de contrepoint : j’étais débordé de travail. Je ne pouvais m’éloigner que pour de courts voyages à Weissenfels, dans la famille de ma femme, qui était aussi celle des Krebs, ou à Halle où je gardais des contacts chaleureux avec mon ami Becker.
Ce n’est donc que durant l’été 1741 que je pus me rendre à Berlin. Pendant ce voyage, j’écrivis plusieurs lettres à ma femme bien aimée. C’était pour moi une grande tristesse de ne pas l’avoir auprès de moi. La ville avait retrouvé son lustre : Frédéric II, le nouveau roi, faisait construire à Potsdam un château qu’il appelait « Sans Souci ». Malgré le souhait qu’il avait exprimé, je ne pus le rencontrer lors de ce premier séjour car il était parti en guerre. La reine mère habitait toujours le château de Monbijou.
Mon fils était débordant d’activité : il me montrait ses œuvres, m’expliquait ses projets : comment deux fils issus d’un même sang pouvaient-ils être aussi différents que Guillaume et Emmanuel !
– Emmanuel, si seulement tu pouvais venir à Leipzig pour que nous soyons à nouveau tous réunis.
– Mais je suis bloqué ici, le roi peut me demander à tout instant.
– Tu ne peux pas lui dire que tu pars en voyage ?
– Toi, tu peux te permettre de dire ça à ces autorités de Leipzig dont tu te plains toujours, mais qui te laissent quand même partir…
– Oui, mais je n’ai pas ton âge…
– Eh bien essaie plutôt de venir ici avec Guillaume, ce serait « Sans Souci ».
– Quand cesseras-tu tes jeux de mots…
À ce moment, notre hôte, le docteur Stahl entra. Il était dos à la fenêtre et, en me tournant vers lui, je fus obligé de fermer les yeux un instant car la lumière m’éblouissait. Il me dévisagea :
– Vous devriez vous reposer, monsieur Bach. Je vois cela à votre teint et au fait que vous clignez des yeux, comme si la lumière vous gênait. Voulez-vous que je vous examine ?
– Ce ne sera pas nécessaire, monsieur, je suis déjà suivi à Leipzig par un de vos confrères qui m’a dit la même chose.
– Bien, comme vous voulez, cher maître. Voici un courrier pour vous.
Je lus :
– Voyons… "Très noble et estimé Monsieur, Très estimé Monsieur mon cousin". Commençant comme ça, ce ne peut-être que Jean-Elias.
"Voyons… vous avez envoyé… bonnes nouvelles … Bonne santé"
Je regardai notre ami médecin qui m’adressa un regard de reproche.
– Ah mais qu’est ceci : « Notre digne Maman », c’est ma femme, « ne se sent pas bien depuis huit jours et on ne sait pas si ce violent échauffement du sang »… Vous pensez que c’est grave, docteur ?
– A-t-elle déjà eu cela ?
– Oui, en début de grossesse, mais je doute que… Je poursuis : Ah je savais bien qu’ils ne me laisseraient pas en paix ! Écoutez ceci : "la Saint Barthélémy… et les élections du conseil tombent dans peu de semaines, nous ne savons pas comment agir en votre absence"… Quand je suis là, ils protestent et quand je ne suis pas là, ils me réclament. Ils font tout pour que je revienne. Tu vois il ne peuvent pas préparer une fête sans moi…
– Mais papa, c’est un peu normal, tu es directeur de la musique…
– Alors toi aussi, tu veux me donner des leçons ? dis-je en éclatant de rire.
– Tu n’es pas inquiet pour notre maman ?
– Penses-tu ! Elle est solide comme un roc. C’est un prétexte que les autorités ont soufflé à Jean-Elias pour me faire revenir !
Je reçus trois jours après une lettre prétendant que notre maman était au seuil de la mort.
Quand je revins à Leipzig, je la trouvai effectivement fatiguée mais une grande joie inondait son visage : elle me confirma que Dieu nous apportait un nouvel enfant. C’était vraiment un signe divin car elle avait presque 40 ans : cela me rappelait l’histoire de Sarah dans la Bible. Pour qu’elle ne se fatigue pas, je dictai à Jean-Elias pour nos amis de Weissenfels chez qui nous devions aller une lettre qu’Anne signa : cette expliquait qu’elle regrettait de ne pouvoir venir mais était souffrante et ne pouvait se déplacer.
Pendant la grossesse de notre maman se produisit une bien étrange aventure dont Jean-Elias, toujours à l’affût des nouvelles, se fit un plaisir de nous raconter tous les détails. Il arriva un jour en courant, tout échauffé et tout excité. Je pensai tout de suite à quelque catastrophe imminente. En fait il s’agissait de notre corecteur le sinistre Dresig, l’adjoint d’Ernesti : il s’était suicidé. Personne ne parla à ce propos de l’attitude méprisante et blessante qu’avait toujours eu Ernesti à son égard. Ce suicide ne contribua bien évidemment pas à améliorer l’ambiance qui régnait dans l’école. Je préfère d’ailleurs à ce propos citer un brouillon du cahier de Jean-Elias qui traînait souvent dans mon cabinet de travail. C’est celui de la lettre que Jean-Elias envoya à un des amis qu’il s’était fait à Dresde, lors de son voyage avec moi. Voici comment il avait vu les choses :
"J’aurais bien voulu aussi vous donner plus de détails sur feu le recteur Dresig, mais on ne sait pas ce qui a pu le pousser à commettre cet acte de Judas. On l’explique par exemple par le fait qu’il avait essuyé le refus de certaines femmes, qu’il avait contracté de nombreuses dettes etc., etc. Mais la vraie raison pourrait bien être qu’il avait abandonné son Dieu, puisqu’on dit qu’il avait souvent parlé religion en termes moqueurs. Il s’est pendu par la collerette dans le fossé derrière la maison du Pasteur près du jardin Wagner et a connu une fin affreuse. C’est un exemple bien singulier qui a surpris tout Leipzig".
Bien sûr, toute la famille fut très impressionnée par cette nouvelle impossible à cacher aux enfants. Heureusement notre petite fille vint au monde peu après, en pleine santé, le 22 Février 1742. Elle reçut le joli nom de Suzanne. Elle avait 34 ans de moins que sa sœur aînée Catherine et 5 ans de moins que sa plus jeune sœur Caroline. Désormais nous avions 7 enfants sous notre toit (si je compte Catherine et Henri). 9 de mes enfants étaient vivants, dont 6 d’Anne. Ces chiffres me paraissaient d’une haute valeur symbolique.
J’étais heureux que la maison soit à nouveau pleine. Mais cela signifiait aussi pour moi le devoir d’élever ces enfants et de les mener à l’âge adulte. Ma paye fixe de Cantor représentait peu de choses par rapport à mes besoins, et c’est une des raisons pour lesquelles j’avais tant d’activités différentes. Grâce à ma réputation et à ma situation auprès de la cour de Dresde, j’étais demandé de toutes parts : pour l’enseignement à des élèves privés, pour des examens d’orgues, pour des concerts, pour des commandes de musiques de fête, pour des cérémonies religieuses… Chez moi on pouvait aussi acheter des partitions de moi, de mes fils ou d’amis. Tout cela nous procurait des revenus tout à fait acceptables.
Je bénissais le ciel que Dieu me garde en pleine santé.
J’avais terminé les trente variations auxquelles je donnai encore une fois le titre de « Exercices pour le Clavier » mais j’y ajoutai « comprenant un Air avec différentes variations pour clavecin à deux claviers ».
Le Baron apprécia beaucoup et Goldberg les jouait remarquablement. Mon Dieu, qu’il était doué, ce garçon : quand il composait, il respectait toutes les règles de l’harmonie, ses fugues et ses canons étaient parfaits. Mais, dans ses compositions, il manquait justement ces petits écarts, ces légères entorses aux règles qui font toute la saveur de notre art.
Comme je l’avais promis aux enfants, j’avais mis aussi en ordre et complété la seconde série de 24 préludes et fugues, exactement sur le même schéma que le Clavier Bien Tempéré que j’avais créé 20 plus tôt à Cöthen.
Mon cahier d’exercice de contrepoint et de fugues m’occupait aussi beaucoup. J’en fis une première ébauche qui comprenait 12 fugues et deux canons. Je montrai ce projet à mes élèves en leur expliquant les différents types de fugue que je traitais. L’un d’eux (peut être Altnickol ou Kirnberger ou peut-être encore le fidèle Kriegel, qui donnait les cours de latin à ma place, je ne sais plus) me dit un jour :
– Mais maître, c’est un véritable Art de la Fugue que vous êtes en train de concevoir !
Je souris :
– Oui, c’est un peu ça !
Quoi qu’il en soit, je n’avais pas assez de temps pour donner à ce projet sa forme définitive. Je me promettais de revenir sur ces manuscrits dans un avenir qui me laisserait peut-être le loisir de revoir celles de mes œuvres qui me tenaient le plus à cœur. Fallait-il vraiment souhaiter que ce temps vienne un jour ?
La composition de musiques d’église ne fut toujours pas, pendant ces années, ma préoccupation essentielle. Le plus souvent je dirigeais ou jouais ce que j’avais déjà composé en le modifiant légèrement selon les circonstances. J’interprétai aussi les œuvres des autres. Il m’arrivait de les adapter. Il y en eut beaucoup mais je me souviens tout spécialement de l’une d’elles intitulée Stabat Mater de Jean-Baptiste Pergolèse, un jeune musicien italien mort à 26 ans, cinq ou six ans auparavant. On racontait qu’il avait composé cette oeuvre très peu de temps avant sa mort. Cette musique était si belle qu’elle provoqua en moi une émotion inexprimable : nous ne surpasserons jamais les Italiens et parfois les Français pour exprimer certains troubles de l’âme. Le texte, en latin, évoquait la douleur de la vierge Marie au pied de la croix : il convenait mal au culte luthérien. Je fis adapter le texte en allemand d’après le psaume 51 « Miserere » qui parle de notre douleur dans le péché. Je modifiai dans la musique certains passages en rendant plus denses certaines parties de violon.
C’est en août 1742 que je reçus une commande qui me procura beaucoup de joie et d’amusement. Il s’agissait d’une musique pour célébrer le commissaire du roi, chargé des impôts, Monsieur de Dieskau, qui s’était vu attribuer des terres au sud de Leipzig. Sous ses ordres était Picander, mon ami et librettiste, avec qui j’avais si souvent travaillé. Ce haut personnage nous convoqua, Picander et moi. Il nous envoya son carrosse qui nous emmena sur la route de Weissenfels et arriva après quelques kilomètres devant un charmant manoir.
Je m’attendais à voir en Monsieur de Dieskau un de ces sinistres employés à la mine sombre et rébarbative mais, à ma grande surprise, je me trouvai devant un jeune homme d’une trentaine d’années, souriant et cordial qui se leva pour venir nous serrer la main.
– Messieurs, je vous ai demandé de venir car je veux que mon arrivée ici soit l’occasion d’une grande fête. J’ai déjà commandé un splendide feu d’artifice. À présent je veux vous commander un spectacle. Si je vous ai choisi Monsieur Bach, c’est bien sûr parce que vous êtes un musicien illustre et qui plus est un musicien du roi. Mais c’est surtout parce qu’on m’a dit que vous aimiez surprendre.
– ? ? ?
– Attendez, vous en saurez plus tout à l’heure. Picander, je vous ai choisi parce que je trouve piquant que celui qui va faire le texte du spectacle, soit justement chargé de percevoir des impôts.
– Monseigneur, je vous remercie de l’honneur que vous me faites.
– Picander, je voudrais que ce texte soit original et c’est pour en trouver la trame que je vous ai demandé de venir avec Monsieur Bach…
Picander fit semblant de réfléchir un instant puis, comme pris d’une inspiration soudaine :
– Monseigneur, je vous verrais bien en Apollon, qui tel un soleil levant est entouré d’étoiles qui pâlissent…
– Vous n’y êtes pas du tout, mon brave Picander…
Picander ne se laissa pas décourager :
– Ou alors Hercule qui entreprend les travaux…
– Écoutez Picander, vous ne comprenez pas ce que je veux : je veux recevoir ici les gens de mes terres, les paysans, les humbles, le peuple et je veux qu’ils s’amusent, qu’ils dansent, qu’ils boivent, qu’ils aillent folâtrer, qu’ils soient gais, qu’ils plaisantent, qu’ils se sentent libérés pour un instant des soucis de leur vie quotidienne… Tenez, je voudrais comme je l’ai déjà vu, un spectacle où l’on n’hésite pas à se moquer des notables.
– Même de vous ?
– Mais bien sûr ! Et aussi du curé, du percepteur, de l’avocat… Et c’est là que je vous demande de surprendre, monsieur Bach : faites moi une musique de village et non pas une musique de cour.
L’idée m’enchanta tout de suite. Picander, le bon Picander se défit tout à coup de son ton solennel et il eut un large sourire. Il dit en me regardant :
– Je vous avais bien dit, Monsieur le Cantor, que je vous ferais un jour mettre en musique des paroles un peu lestes…
Un rire de bon augure nous prit tous les trois et Monsieur Dieskau prit congé :
– Je vois que vous avez compris. Revenez me voir dans quelques jours.
Rarement je me suis autant amusé qu’en travaillant à cette comédie avec Picander. Ma musique n’avait rien de savant et empruntait à des chansons de l’époque, elles se succédaient à des rythmes différents.
Une jeune femme essayait de chanter comme les nobles, un jeune homme aussi, mais ils préféraient tous aller à la taverne. Picander s’était surpassé en écrivant des textes gais, brefs et drôles :
– Allons Marion, donne-moi ta jolie bouche.
– Si tu ne voulais que ça ! Mais je te connais, espèce de bon à rien, tu en veux toujours plus !
– Ça gronde dans mon ventre : comme si une armée d’abeilles se battaient.
– Monsieur le percepteur, laissez-nous au moins notre peau !
Le jour de la représentation, le temps était digne d’une fin d’août. Il se trouve que le Roi était à Leipzig ce jour-là. Sur la pelouse devant le manoir, ces gens de la campagne dansaient au son de la cornemuse. Miroir de notre spectacle, cette pelouse était devenue la taverne. Le vin et la bière coulaient à flots. J’en profitai aussi. Depuis quelques temps, je prenais de plus en plus de plaisir à manger et à boire, et ma corpulence s’en ressentait !
Ce mois d’août 1742 avait été fort occupé : l’anniversaire du roi en début de mois, et, trois jours avant cette fête de paysans, l’élection du maire.
Tout le monde admirait ma forme et ma vitalité. Comble de bonheur, j’eus la joie d’acquérir deux jours plus tard dans une vente aux enchères La Grande Bible Allemande de Luther, dans l’édition de Carlov : cela me coûta 5 000 F, à peu près 10 % ce que m’avait donné Dieskau pour ma musique !
Je vivais alors une époque bénie.
Après avoir retardé son départ le plus longtemps possible, je laissai enfin partir Jean-Elias et c’est en cette fin d’année 1742 qu’il nous quitta : la saison était froide et je dus lui prêter mon manteau et mes bottes pour le voyage. À 37 ans, le pauvre garçon n’avait même pas de quoi s’habiller pour un voyage ! Je trouvai vite, parmi mes élèves qui pour la plupart poursuivaient leurs études à l’Université, des solutions pour le remplacer.
Jean Frédéric Doles était l’un d’eux : en 1743, il devait avoir une trentaine d’années et cherchait toujours à paraître plus vieux que son âge pour être mieux considéré: heureux homme ! Il était né en Thuringe, non loin d’Ohrdruf, et comme à tous les thuringiens, je lui avais fait bon accueil. Quand il arriva à Leipzig, il quittait un poste de préfet de chœur et cherchait à devenir cantor. Il était doué et très curieux de musique moderne. Il gagnait sa vie en donnant des leçons de musique aux bourgeois de la ville. Je me souviens de discussions épiques entre lui et mon fils Guillaume à propos de l’évolution de la musique.
– Mais voyons, Doles, les bourgeois sont incapables de comprendre la musique !
– Détrompe toi, Guillaume, ils sont en train de changer : la musique est sortie des églises et des cours des princes.
– Tu sais, depuis toujours, les paysans dansent au son des cornemuses et chantent des chorals le dimanche… Si c’est ce que tu appelles la musique…
– Allons, ne sois pas emporté, tout de suite.
– Et puis… tu sais bien que seuls les étudiants ont le temps de faire de la musique, les bourgeois sont trop occupés…
– Allons, Guillaume, regarde ce que fait ton père chez Zimmermann… Les bourgeois y viennent pour écouter de la vraie musique.
– S’il n’y avait pas le café, ils ne viendraient pas… D’ailleurs, ils viennent de moins en moins.
– Mais c’est parce que les étudiants ne sont pas payés et sont de moins en moins bons…
– Ah ça c’est vrai, je ne dis pas cela pour toi, Doles, mais le niveau baisse. Il faut dire que, comparé aux professionnels de Dresde, c’est un autre monde ! Et puis, quand je pense à la place qu’on donnait à la musique de mon temps à l’école, c’est normal après tout que le niveau baisse ! Tu te rappelles, père, dit Guillaume en se tournant vers moi, avant Ernesti et consort, de la qualité de nos orchestres d’étudiants ?
– Eh bien, justement, dit Doles, je peux te certifier qu’il y a à Leipzig un public de marchands et de notables prêts à écouter de la musique avec de bons musiciens.
– Oui, mais les bons musiciens peuvent jouer aussi bien de la musique pour chiens que de la bonne musique !
– Et alors, c’est le public qui choisit, non ?
La pipe à la bouche, j’écoutais les deux jeunes hommes : tous deux avaient raison sans doute… Je les interrompis par une question à Doles :
– Tiens, à propos, où en est Gleditzsch ?
Doles devint rouge d’embarras.
– Vous… vous connaissez Monsieur Gleditzch ?
– Bien sûr, sa femme a même été marraine d’un de mes enfants.
– Mais alors il vous a dit…
– Il aurait été tout de même étrange qu’il ne me tienne pas au courant.
– Alors vous savez que depuis deux ans, il met sur pied un Grand Concert, qui comprendra…
– Seize membres qui acceptent de payer 10 000 F par trimestre et seize musiciens qui sont en train d’être sélectionnés…
– Et vous savez que je…
– Que tu es des leaders de ce groupe. Je sais aussi que tu aurais pu me le dire avant, mon petit Doles…
– Mais maître, mai…
Guillaume éclata de rire :
– Avec ce genre de gaffe, tu n’es pas près d’être cantor !
J’ajoutai en souriant :
– Je sais même que Gerlach en fait partie aussi. Ceci dit, je crois que les orchestres d’amateurs ont aussi du bon et qu’ils ont leur place à côté de ce Grand Concert que tu vas contribuer à créer. Quant à moi, je continuerai chez Zimmermann, mais peut-être pas aussi souvent qu’avant.
– Maître, pardonnez mon insolence, mais Gleditzsch vous a t’il proposé de…
– Ah ça, mon petit Doles, tu le sauras bien assez tôt.
Je n’étais pas mécontent que les choses tournent ainsi, car cela me rendait plus libre de participer à tel ou tel concert selon mon envie… et mes besoins financiers du moment.
Ce que je n’avais pas dit à Doles, c’est que la musique avait atteint un tel état de décrépitude à l’école en raison de l’attitude d’Ernesti, que les bourgeois et marchands s’en étaient émus et avaient proposé de verser plus d’argent pour l’enseignement de la musique à l’école : nous allions peut-être pouvoir un jour payer les adultes qui tenaient les parties de basse dans le chœur.
La mort du fils de Christian Weise, en avril 1743, pendant la période de Pâques, m’attrista énormément. La nuit où il mourut sa femme accoucha de deux enfants jumeaux. Il n’avait pas 40 ans. Avec lui disparaissait une lignée d’hommes exceptionnels, symboles des temps passés, période de foi profonde, que j’avais vécue avec tant de ferveur ! La cérémonie eut lieu à Saint Nicolas et le surintendant Deyling fit un sermon s’inspirant du prophète Isaïe : « Voici le Dieu de mon salut, j’ai confiance et ne tremble pas ».
Cette mort fut suivie d’une période sombre : on parlait de guerre.
Les routes n’étaient plus sûres. Des soldats parcouraient la campagne en pillant les paysans et en volant les voyageurs. Je ne pus même pas aller à Berlin au mariage de mon fils Emmanuel au début de 1744. (La même année Ernesti se décida enfin à se marier : il avait presque 40 ans !). Bientôt, il ne fut même plus possible d’aller à Dresde ni même de sortir de la ville. Déjà le Roi avait quitté la Saxe pour la Pologne. On disait que les Français, alliés au Roi de Prusse allaient tout détruire. Ce que je craignais depuis que j’étais enfant arrivait : c’était la guerre.
Je me souviendrai toujours du 21 novembre 1745. Je travaillais dans mon cabinet. Je regardai machinalement par ma fenêtre. Vous savez que de là on surplombait les remparts et qu’on voyait au loin, les champs et la campagne. Parfois même, quand le temps était très clair, on apercevait, comme des épines posées sur l’horizon, les clochers des églises. C’était le cas, ce matin du 21 novembre 1745. Il faisait froid. Le ciel était si clair que je croyais avoir retrouvé ma vue de jeune homme : je voyais ces clochers, je voyais ces fines épines. Et puis, le long de la route, je vis comme une colonne de fumée qui montait jusqu’au ciel. Je me dis que c’était le vent qui soulevait la poussière et me replongeai dans mon travail. Combien de temps après ai-je à nouveau regardé par la fenêtre ? Toujours est-il que je vis, venant de l’horizon, s’approcher des soldats, des chevaux, des canons. Ils s’arrêtèrent derrière le jardin Appel. Puis j’entendis le son du canon. Je ne pus empêcher les enfants de monter : ils voulaient voir.
– Papa, papa, qu’est ce qui arrive ?
– Ne vous inquiétez pas dit Catherine, ma fille aînée, papa va tout arranger.
– Sébastien, qu’allons-nous faire ? dit notre maman
– Vont-ils entrer dans Leipzig ? dit Frédéric 15 ans
– Nous allons les battre, nous sommes les plus forts, dit Jean Chrétien, 12 ans
– Les deux petites filles s’étaient blotties dans les jupes de leur grande sœur
On entendait en bas les râles de Henri, 23 ans qui, quand il sentait un danger et qu’il avait peur, oscillait d’avant en arrière, toujours plus fort.
Liesgen, 21 ans, n’était pas là : je lui avais permis d’accompagner mon brillant élève Altnickol pour une course en ville.
Les notables n’avaient pas prévu de faire des provisions pour un siège. Les soldats étaient en trop petit nombre à Leipzig pour défendre la ville. Après trois jours, la faim commença à nous tenailler. Le duc de Weissenfels, qui avait succédé à Flemming comme chef de la garnison, dut se rendre au bout de dix jours. Les soldats prussiens entrèrent dans Leipzig. Sur ordre de leur roi, ils demandèrent une rançon si forte que la ville ne put payer. Chaque habitant dut alors verser une somme d’argent, en métal, en or ou en fourrage. Moi, je ne pouvais pas payer en musique !
Noël 1745 : des soldats partout. Aurais-je pu imaginer un Noël dans la guerre ?
Ils restèrent là un mois entier puis repartirent un matin, comme ils étaient venus. C’était le 1er Janvier 1746.
Tous les marchands disaient que la ville était ruinée.
Mais les marchands sont aussi prompts au désespoir qu’à l’enthousiasme. En réalité la ville n’avait pas été détruite. Pas d’incendie comme celui que j’avais vu à Mülhausen et qui restait gravé dans ma mémoire. Pas de destructions, seulement quelques pillages: les soldats de Frédéric II étaient maintenus dans une discipline de fer.
En réalité la fin de cette guerre marqua le début d’une période de paix et de grande prospérité. J’ose croire que les princes de ce monde se sont mis d’accord et que nous ne connaîtrons plus jamais la guerre.
Pendant ces années, j’eus de nombreuses commandes d’expertise d’orgues : le chantier de l’église Saint Jean à Leipzig (rappelez-vous c’est près de cette église dans les jardins que je jouais pour Zimmermann en été), celui de Saint Thomas, toujours en travaux, le chantier du splendide orgue de l’église de Naumburg, (construit par Hildebrandt, celui qui m’avait fait mon clavecin-luth et fut supervisé par Silbermann et moi), le chantier de l’église de Zschortau. Selon les cas je recevais entre 10 000 et 15 000 F, tous frais payés bien sûr.
En ce qui concerne ma famille, les nouvelles étaient excellentes : moi, je venais d’avoir soixante ans et j’avais toujours une santé sans faille. Simplement, ma vue n’était plus aussi fine qu’avant. Je remarquai aussi que j’avais besoin de plus en plus de lumière pour lire mes partitions : c’était sans doute aussi une conséquence de l’âge. De toutes façons ces détails m’importaient peu. Je n’avais pas le temps de penser à tout cela.
Guillaume avait déjà 36 ans et Emmanuel 32 !
Guillaume avait été nommé organiste à Halle. Après treize ans (treize ans déjà !) il avait démissionné de Dresde. Il avait trouvé à Halle un poste important car en même temps qu’organiste, il y était en plus, comme moi à Leipzig, directeur de la musique. Je priai le ciel que ses relations avec les notables de Halle soient meilleures que celles que j’avais ici à Leipzig. Car je connais bien mon fils : capable des pires maladresses tant il est tout entier tourné vers son art et aussi vers lui-même! Moi, au moins, je savais parfois avoir la souplesse nécessaire. Halle ! Que de souvenirs ! C’est là que j’avais inspecté avec Kuhnau cet orgue dont mon fils était désormais titulaire. C’est là que j’avais refusé le poste d’organiste malgré l’insistance des habitants. C’est là aussi que j’avais cru pouvoir rencontrer Haendel…
Emmanuel, quant à lui, poursuivait sa carrière auprès du roi de Prusse Frédéric II. Il était son accompagnateur officiel. Chaque soir, de 7h à 9h, il jouait du clavecin quand le roi jouait de la flûte. Contrairement à Guillaume qui est d’humeur plutôt sombre et fantasque, Emmanuel sait se faire des amis. Il tient sans doute cela plus de sa défunte mère que de moi. Ainsi il participe à tous les évènements musicaux et littéraires de Berlin.
Mais on me réclamait là-bas : mon fils m’écrivait que le roi lui-même voulait me voir et demandait souvent à Emmanuel pourquoi je ne venais pas. Et puis, il y avait mon premier petit-fils, né à Berlin pendant le siège de Leipzig. Je n’avais même pas pu aller au mariage de son père ! Mais j’étais aussi impatient d’écouter quel genre de musique on jouait à Berlin, si elle était vraiment différente de celle de Dresde. Les musiciens y étaient ils aussi bons ? Comment avaient progressé, en quittant Dresde et en venant à Berlin, tous ceux que j’avais bien connu : les frères Benda, Graun et surtout Quantz. Ils touchaient paraît-il des sommes astronomiques car ils avaient la faveur du roi. Avaient-ils avec mon fils créé un type de musique nouveau ?
Le Baron Keyserlink, qui d’ambassadeur à Dresde était passé ambassadeur à Vienne et venait d’être nommé à Berlin, auprès de Fredéric II me conseillait lui aussi de répondre à l’invitation du roi de Prusse.
J’hésitai longtemps à venir. Je me demandais quel accueil me ferait la mère du roi. Qu’était-elle devenue ?
Je ne voulais pas non plus déplaire au prince électeur de Saxe et Roi de Pologne, le fils d’Auguste le Fort, qui régnait à Dresde et qui m’avait fait musicien de sa cour.
Ce souverain vint à Leipzig pour la Foire en avril 1747 : il séjourna du 24 avril au 6 mai. Or j’avais enfin prévu de partir pour Berlin le premier mai, donc pendant son séjour.
Notre maman me dit :
– Sébastien, tu ne peux pas partir maintenant voir le roi de Prusse à Berlin ! As-tu donc oublié qu’il y a à peine 6 mois, ses soldats occupaient Leipzig ? Il a vaincu le souverain dont tu es le musicien et qui est dans nos murs aujourd’hui, après deux ans d’absence ! Tu vas être banni, renvoyé ! Et nous serons à la rue !
– Allons, petite maman, reste calme, ma chère petite chanteuse, ma si bonne copiste et conseillère, ma tendre jardinière ! Réfléchis : je suis bien trop connu pour qu’il me bannisse. Et puis le souverain sait très bien que mes deux aimés travaillent pour le roi de Prusse: Emmanuel à Berlin et Guillaume à Halle. Tu sais, ils font tous semblant de ne plus pouvoir me supporter mais en réalité ils tiennent à me garder…
– Fais attention, Sébastien, il arrive toujours quelque chose quand tu pars en voyage… sans moi.
– Mais il faut absolument que j’aille là-bas ! Au fait, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi ?
– Sébastien, tu sais bien que c’est impossible !
– Alors, tu veux que je reste ici au risque de mécontenter le prince le plus puissant d’Europe qui fait travailler mes deux fils aînés ? Et s’il me proposait un poste à Berlin ?
– Sébastien ! Changer à ton âge ! Mais tu dois te ménager !
Notre maman m’avait parlé presque comme à un vieillard et non comme à un mari. Je ne voulus pas lui montrer combien cela me blessait: ainsi j’étais si vieux que cela ? Eh bien j’allais montrer au monde entier que j’étais en pleine forme : j’irais voir le roi de Prusse. C’était décidé.
– Écoute, petite maman, je crois que tu te fais du soucis pour rien. Je te promets d’en parler autour de moi et de ne pas partir si je vois que cela pose le moindre problème.
Le premier mai au matin, je partais pour Berlin. Je passai par Halle pour prendre Guillaume. Le voyage fut un vrai bonheur : le printemps était là, les arbres prenaient leurs feuilles, les oiseaux chantaient, cela me rappelait mon premier voyage avec Erdmann, à pied celui-là.
J’avais avec mon fils des discussions infinies. Il pensait qu’on pouvait faire de la bonne musique et parler au cœur sans qu’il y ait de contrepoint savant avec plusieurs voix. Moi je lui répondais que c’était vrai, que j’avais composé beaucoup d’œuvres à une voix, que j’avais entendu ses œuvres, que je les trouvais intéressantes mais que l’art suprême en musique c’était pour moi autre chose. Au delà du cœur, il y avait la recherche de cette délectation de l’âme qui permet d’atteindre des profondeurs inouïes. Et cela n’est possible que par des moyens que nos prédécesseurs, lentement, ont découvert et nous ont transmis, à travers leur musique, leur foi, leurs signes, leur langage secret dont la superposition des lignes mélodiques et le contrepoint sont l’aboutissement parfait.
En début d’après-midi, le dimanche 7 mai 1747 nous approchions de Berlin. Nous n’avions pas à nous rendre en ville car Emmanuel habitait près du Palais du roi, à Postdam, sur la route de Leipzig. Des gens d’armes nous arrêtèrent et nous demandèrent nos noms, ce qui eut le don de mettre Guillaume de forte méchante humeur.
Non loin du château, le logement qu’habitait Emmanuel était fort agréable. Il nous accueillit avec sa gentillesse habituelle :
– Alors, le père et le fils ont bien « Berliné » (Encore un de ses jeux de mots !). Entrez donc.
Je vis alors apparaître une charmante jeune femme qui tenait dans ses bras un bambin d’environ deux ans. Derrière elle se tenait un homme et une femme d’apparence agréable et joviale mais qui me dévisageaient comme si j’étais quelqu'être étrange. La jeune femme avait l’air si jeune que je fus fort surpris quand Emmanuel nous dit :
– Je vous présente Jeanne, ma femme, et Jean-Auguste, ton premier petit fils, père. Et puis voici les parents de Jeanne.
La jeune femme resta sans voix en me regardant.
Les parents s’inclinèrent respectueusement.
– Avant toutes choses, dis-je, je voudrais que nous rendions grâces à Dieu qui a permis que nous soyons réunis ici.
Je dis une prière puis je leur demandai de chanter avec moi un choral.
Après un instant de silence, Emmanuel prit la parole :
– Euh… voilà… Nous finissions de déjeuner et mon beau-père vous a fait une surprise…
– Oui, monsieur le Maître de Chapelle, j’ai choisi pour vous un excellent vin blanc, dit le père de Jeanne.
J’appris rapidement que le beau-père d’Emmanuel était négociant en vins. J’appris aussi, en goûtant le vin, que ce monsieur était un grand connaisseur.
– Mais je manque à tous mes devoirs, dit Jeanne. Vos bagages…
– Oui, je voudrais bien me changer car la route a été longue.
– Je vais vous montrer votre chambre.
À ce moment on entendit des coups violents contre la porte d’entrée.
– Ouvrez, au nom du roi.
Emmanuel se précipita et entrouvrit la porte.
– Le roi demande que Monsieur Bach père vienne immédiatement au château, son carrosse vous attend.
– Mais il faut que je me change, que je mette mon habit noir de Cantor.
– L’ordre du roi est que vous veniez sur-le-champ.
– Nous vous suivons, dit Emmanuel, sans montrer la moindre impatience....Le roi veut sans doute te faire écouter ses musiciens préférés…
Je regardais par la vitre du carrosse, je distinguai dans la brume les contours d’un bâtiment flambant neuf, splendidement décoré :
– Mais ce n’est pas le château que j’avais vu…
– Non, celui-là c’est le fameux Sans Souci… Le roi l’a inauguré lundi dernier mais ne l’habite pas encore… Nous allons au château que tu connais déjà. Tu sais que le roi a acheté à Silbermann plusieurs pianoforte. Je suis sûr qu’il va vouloir te les faire essayer.
– J’espère qu’il a acheté les plus récents car les premiers avaient un registre aigu détestable et de plus, il fallait taper sur les touches comme un forcené pour obtenir un son !
Mes deux fils se mirent à rire en se souvenant de mes discussions orageuses avec Silbermann.
– Rassure-toi, père, le roi prend toujours ce qu’il croit être le plus nouveau et le plus beau : il veut « acheter » un célèbre écrivain français du nom de Voltaire, et il a bel et bien « acheté » Leipzig récemment, tu en as été le témoin, père.
– Emmanuel, tes plaisanteries te joueront un mauvais tour.
Des laquais nous introduisirent dans l’antichambre du roi. J’étais fort gêné avec mon habit de voyage. Je me rassurai en pensant que nous allions écouter un concert avec le roi jouant de la flûte, car c’était son heure… Il était 19 heures.
L’attente ne fut pas longue : le roi me réclamait.
J’entrai dans la salle où se tenait le roi. Il y avait là beaucoup de monde. J’aperçus le Baron qui me fit un signe. Je reconnus tout de suite la mère du roi qui me sourit quand je passai devant elle et me regarda avec une insistance qui me gêna. Les ans avaient marqué son visage de toutes les déceptions et toutes les résignations qu’elle avait dû supporter. Le roi s’avança vers moi :
– Monsieur Bach, vous voici enfin… comme je suis aise de vous voir.
– Sire, je sollicite de votre gracieuse Majesté la plus grande indulgence car mes habits ne conviennent guère…
– Je vous pardonne volontiers car c’est moi le responsable…
– Je remercie votre majesté de son infinie complaisance à mon égard…
– Votre renom mérite bien…
– Je n’en suis que plus contrit de n’avoir pu faire honneur…
– Bien, ce la suffit, monsieur le Cantor, tous mes musiciens sont réunis ici ce soir : beaucoup sont de vos amis, je crois.
Un murmure de contentement parcourut les musiciens et Quantz se permit même de crier « Bravo » ce qu’il était le seul autorisé à faire en présence du roi.
– Mais je dois vous dire que parmi vos admirateurs les plus empressés figurent ma mère et ma sœur Anne-Amélie.
Il fit un geste montrant que je devais me diriger vers elles.
J’allai m’incliner d’abord devant la mère du roi, sans me mettre à genoux car mettre un genoux à terre était à présent pour moi un exercice un peu douloureux. Comme je m’approchai d’elle, je fus heureux de constater qu’elle avait repris une attitude digne de sa position. Mais je fus saisi de stupeur en voyant sa fille: je crus un instant voir la princesse avec qui, à la cour de Celle j’avais eu cette mystérieuse connivence. Mais c’était sa fille et non elle qui était là devant moi. Elle me sourit et me dit :
– Monsieur Bach, comme je suis heureuse de vous voir ! J’admire tant ce que vous faites.Vous ne le savez pas peut-être pas, mais moi aussi je compose.
Emmanuel vint se joindre à nous. Je le vis donner discrètement à la sœur du roi une feuille de papier sur laquelle je crus distinguer, malgré ma vue faiblissante, des notes de musique.
Alors le roi parla :
– Monsieur Bach, je vous ai réservé quelques surprises. Venez voir. Tout le monde nous suivit à l’exception de la mère du roi qui restait assise.
Il me montra un pianoforte de Silbermann du plus récent modèle, dont je savais qu’il sonnait bien.
– Allons Bach, montrez nous ce que vous pouvez faire avec cet instrument.
Je préludai et m’aperçus que l’instrument était mal accordé. En quelques minutes, le mal était réparé, si vite que j’entendis des oh ! d’admiration. J’improvisai puis m’arrêtai. Le roi daigna applaudir et tous s’empressèrent d’applaudir aussi. Il s’approcha de sa sœur, lui prit le papier qu’elle lui tendait, le lut attentivement puis le mit dans une des poches de son pourpoint.
Puis il m’emmena dans une autre salle et voulut que je joue sur un autre pianoforte. Je trouvai amusant de tester les différence de toucher et de sonorité entre les deux pianoforte.
Puis vint un autre pianoforte, puis encore un autre : il y en eut au moins une dizaine. Je voyais Emmanuel courir de salle en salle pour accorder les pianoforte avant que je joue. Je me demandai quand cela finirait. J’appris plus tard que ce roi avait acheté à Silbermann tous les pianoforte qu’il fabriquait ! Loin de m’impatienter, cette promenade dans le palais me détendait plutôt et je me préparais ainsi à l’épreuve qu’Emmanuel m’avait annoncée et qui était d’ailleurs habituelle chez les princes et dans les concerts. Le roi allait me demander d’improviser une fugue sur un thème qu’il me donnerait au dernier moment.
Je le vis regarder encore une fois la feuille de papier que sa sœur lui avait remise. Puis il me dit :
– Eh bien, monsieur le Cantor, vous nous avez fait entendre sur ces pianoforte une musique fort agréable, bien qu’assez différente de celle que je demande à mes musiciens. Et quel virtuose ! Votre fils lui-même…
Il sourit à Emmanuel et fit exprès de ne pas terminer sa phrase, ce qui mit l’assistance de fort bonne humeur…
Mais vous êtes ici pour nous montrer l’art dans lequel vous surpassez tout le monde : celui du contrepoint et de la fugue.
Il se dirigea vers un clavier, s’assit, se concentra et se mit à jouer quelques notes. C’était le thème qu’il avait choisi et qui m’impressionna fort par sa beauté. Improviser une fugue sur ce thème était un pari comme je les aimais : rien n’est impossible. Je vis mon fils Emmanuel sourire à la Princesse Anne-Amélie.
Je me concentrai.
Je vis dans ma tête la construction d’une fugue à 3 voix.
Je commençai à jouer.
Quand j’eus fini, je fus longuement applaudi, par le roi tout d’abord, tous les autres suivant.
J’entendis le roi dire à sa sœur, à voix basse :
– Vraiment c’est un tour de force, j’ai eu raison de le faire venir car après lui, on ne pourra plus entendre une chose pareille. As-tu suivi toutes les voix… ? Attends, je vais lui proposer autre chose.
Le roi ne savait pas combien mon ouïe était fine et que j’entendais parfaitement ce qu’il disait…
Je devinai la question qu’il allait me poser ensuite : faire une autre fugue sur le même thème mais avec six voix. Cela me paraissait impossible tout de suite.
Il me dit, comme s’il voulait me tendre un piège :
– Bach, pourriez-vous maintenant improviser une fugue… à six voix avec…
– …avec un thème de mon choix, si vous le voulez bien, sire.
Le roi eut un mouvement de surprise, marque un temps d’arrêt puis prononça ces mots :
– Eh bien soit !
Puis il regarda sa sœur et lui sourit d’un air triomphant.
À la fin de cette fugue qui je dois l’avouer me parut fort réussie, des applaudissements crépitèrent avant le roi lui-même. Je regardai qui avait osé… : c’était la jeune sœur du roi, Anne Amélie qui avait applaudi avant son frère.
À la fin de cette audition, elle vint vers moi, avec le même sourire, exactement le même sourire que sa mère à Celle, 47 ans auparavant au château de Celle et, s’éloignant de la foule. Elle m’entraina loin de la foule et me dit :
– Monsieur Le Maître de Chapelle. Oui je m’adresse en vous au Maître de chapelle et non au célèbre virtuose que mon frère a fait venir ici. J’ai eu en main la messe que vous avez faite pour la cour de Dresde.
– Princesse, vous êtes trop bonne et suis confondu de reconnaissance car les maigres talents que le ciel m’a donné ont pu ainsi être remarqués de votre gracieuse altesse.
Je ne savais plus trop ce que je disais. Je me sentais redevenir un jeune homme devant cette jeune femme qui pouvait avoir une vingtaine d’années. Je savais pourtant qu’elle était à la tête d’un couvent, le couvent de Quedlinbourg.
– Vous avez fait là une œuvre digne d’être connue des hommes et dont la mémoire devrait être gardée.
– Mais madame peu de musiques d’église sont jouées plusieurs fois : elles sont destinées à des offices précis, le musicien les joue une fois, deux fois, parfois trois fois, puis d’autres modes arrivent. Bien sûr, il y a quelques exceptions comme la Brockes Passion et en particulier celle de Telemann…
Je ne sais pourquoi, mais j’eus tout à coup l’impression que je doutais de mes propres paroles.
– Monsieur Bach, la Brockes Passion passera mais votre messe, elle, ne passera pas.
– Madame, vous êtes trop bonne et votre…
– La vie religieuse, monsieur Bach, m’a appris à comprendre ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas. De plus, comme je vous l’ai dit, je compose moi-même et je crois discerner la vraie valeur d’une œuvre, ce que mon frère ignore totalement…
Allais-je encore une fois être pris dans les confidences de cette famille ?
– Monsieur Bach, reprit-elle, je voudrais vous demander instamment de terminer votre œuvre. Ne faites pas de votre messe une simple messe luthérienne mais une œuvre universelle qui outre le Kyrie et le Gloria, comprendra le Sanctus, le Credo et l’Agnus. Faites m’en la promesse…
Elle avait pris un ton si sérieux que j’osai la regarder en face et lui dit, comme dans un acte de foi :
– Je vous le promets madame…
Dieu avait parlé par sa bouche. Chaque jour, depuis cette rencontre, j’allais penser à cette sainte mission que me donnait la Princesse. Chaque jour, je travaillerais dans mon esprit ou sur le papier à réaliser cette messe qui serait l’accomplissement de tout ce que j’avais conçu pour les musiques d’église. Chaque jour…
– Ma fille, que fais-tu avec Monsieur Bach, sais-tu qu’il est un séducteur !
La reine mère était arrivée sans que nous nous en rendions compte.
La mère et la fille me quittèrent, le passé tenant le bras de l’avenir. La fille se retourna vers moi. Son visage grave était devenu sourire radieux.
Quand je pense que le matin même de ce dimanche, j’étais encore en voyage…
– Père où étais-tu ? Tout le monde te cherchait ! Nous allons prendre congé du roi et partir car tu dois être fatigué.
C’était mon fils Emmanuel qui me ramenait aux choses d’ici-bas.
En rentrant un excellent repas nous attendait chez Emmanuel. Je n’éprouvai aucune fatigue.
– Et qu’y a t’il au programme demain ?
– Le roi nous attend à l’église du Saint Esprit pour que tu lui joues de l’orgue.
– Décidément il n’y en a que pour moi. Mais qu’en pensent les autres musiciens ?
– Oh ! tu sais, ils sont habitués… Le presse-citron est à l’œuvre…
– Le presse-citron ? Que veux-tu dire ?
– Quand le roi fait venir quelqu’un qu’il croit exceptionnel, il en tire tout ce qu’il peut et après n’a qu’indifférence à son égard. Comme un citron qu’on presse : une fois qu’il n’y a plus de jus, on le jette.
– Fais attention Emmanuel, ne va pas raconter que c’est toi l’inventeur de cette plaisanterie ! Mais… Quantz, les Graun et toi, Emmanuel, vous n’êtes pas des citrons.
– Nous, ce n’est pas la même chose, nous sommes pour lui des objets familiers, comme ses fauteuils, ses chaises, ses fusils ou…sa flûte, et dont il ne peut se passer.
Le lundi se déroula exactement comme l’avait dit Emmanuel : le roi insista sans cesse pour que je multiplie les tours de force. Non seulement je jouai pour lui à l’orgue de l’église du Saint Esprit mais le soir, il voulut encore m’entendre improviser une autre fugue à 6 voix. Il n’en fallut pas davantage pour me faire réagir. Dès ce moment je décidai que j’allais lui montrer que je n’étais pas un citron comme les autres. J’allai faire autour de « son » thème un nouveau recueil. Je le fis savoir et en parlai à mes deux aînés pendant ce séjour à Berlin.
– Je voudrais trouver un titre à ce recueil.
– Tu pourrais l’appeler Exercice pour le Clavier, comme tes œuvres précédentes.
– Mais non pour un roi, il faut autre chose.
– Pourquoi pas « Célébration pour le roi ».
– Mais non, ce n’est pas le roi que je veux célébrer, c’est la musique que je vais lui offrir.
– Tiens, voilà, j’ai trouvé le titre qu’il te faut : Offrande musicale à sa Majesté le roi de Prusse.
– Bonne idée ! Dès que je rentre à Leipzig, je me mets au travail.
– Promets que tu le feras éditer.
– Bien sûr, c’est devenu une habitude pour moi maintenant !
– Chez Schübler ?
– Oui, je pense…
– À propos, père, je ne t’ai pas félicité pour ta transcription pour orgue de 6 musiques avec choral extraits de tes musiques d’église ! Je les ai bien reçues et en ai même déjà vendu quelques unes. Tu as vraiment su choisir celles que nous préférions tous !
– Oui… cela m’a rappelé des souvenirs quand nous les chantions avec le chœur de Saint Thomas, dit Guillaume.
– Ne remue pas le couteau dans la plaie, mon fils. Quand je pense à la situation maintenant.
Je restai quelques jours à Berlin. Emmanuel me faisait visiter la ville. Un jour, il m’emmena au nouveau théâtre. J’entrai avec lui, regardai le plafond voûté et lui demandai tout de suite de monter avec moi dans la galerie supérieure.
– Regarde, Emmanuel, l’architecte a réussi un tour de force sans le savoir. Tu vois ces arcs brisés qui soutiennent le plafond voûté ?
– Oui.
– Eh bien, va à l’autre bout de la galerie et moi je reste là. Maintenant, tourne-toi vers le mur. Tu es prêt ?
– Euh… oui.
– Bon je parle tout bas, tu m’entends ?
– Mais très bien, c’est incroyable !
– Maintenant éloigne-toi du mur. Je vais continuer à parler tout bas. Voilà… tu as entendu ?
– Rien du tout. Mais comment pouvais-tu savoir ?
– Ah ça, mon fils, c’est l’expérience, l’observation et le travail !
Sur le trajet du retour, j’eus avec mon fils Guillaume une bien étrange conversation. Guillaume était depuis toujours celui à qui je livrai mes pensées les plus intimes. Nous étions parti tôt le matin après avoir pris congé d’Emmanuel.
Je regardais par la fenêtre de notre calèche :
– Le temps est brumeux aujourd’hui.
– Mais père, il fait un temps splendide.
– Ah bon !
Ma vue était-elle entrain de baisser à ce point ?
– Père, tu as entendu ce qu’a dit le roi ?
– Quand ?
– Il a dit en parlant de toi « après lui, on ne pourra plus entendre une chose pareille ».
– Oui et alors ?
– Père, je voudrais te dire quelque chose…
– Oui, Guillaume…
– Pourquoi ne pas faire éditer tes musiques d’église ?
– Mais pourquoi donc ? Je les ai toutes classées et celui qui voudra les retrouver pourra le faire sans problème.
– Mais je pense en particulier à ta messe… Finis-la.
– Toi aussi ?
Je fus frappé de cette coïncidence, Anna Amélie et mon fils m’avait dit pratiquement la même chose…
Je retrouvai Leipzig avec la maison, l’école, mais surtout ma table de travail : j’avais en perspective du travail comme rarement au cours de ma vie. Composer cette Offrande Musicale au roi de Prusse, finir mon cahier de contrepoint et de fugues, réfléchir aussi à cette messe que j’avais décidé de construire…
J’avais déjà conçu pendant le voyage le plan de l’Offrande Musicale. Il y aurait trois parties : une partie de virtuosité au clavier et dans le contrepoint (celle que le roi avait recherchée en me faisant venir), une partie divertissement (dont le roi me croyait sans doute incapable), une partie technique (dont le roi ignorait sans doute la rigueur de construction). Avec Guillaume, nous avions trouvé un jeu de mot pour donner un nom à ces fugues à partir des lettres R I C E R C A R qui avaient plusieurs sens: c’était un mot italien évoquant une ancienne forme musicale et qui voulait dire « cherchez et recherchez ». Nous lui avions donné un autre sens pour le roi qu’on peut traduire par le jeu de mots : « Roi Injonction Chant Et Reste Canons Artistement Résolus ».
Tout cela ressemblait à un discours de rhétorique avec un plan précis comme celui d’un orateur romain : la virtuosité ce seraient les fugues, (celle que j’avais improvisé et une autre à six voix que j’avais refusé de tenter devant le roi), le divertissement serait une sonate pour flûte (injouable pour le roi, car trop difficile pour un amateur comme lui), et la technique ce seraient des canons (seul les connaisseurs pourraient apprécier).
Le Roi n’avait vu en moi que le virtuose : il n’avait pressé qu’un petit tiers du citron !
Pendant que je travaillai à l’Offrande Musicale, c’était au mois de juin 1747, j’eus la visite d’un de mes anciens élèves qui s’appelait Laurent Mizler : c’était un jeune homme charmant, docteur en médecine, qui se voulait homme de grande culture. C’est pourquoi il avait fondé une société de prétendus savants comme il y en avait tant: chaque membre devait avoir des connaissances en mathématiques et en philosophie et présenter chaque année une œuvre théorique ou pratique sur la musique.
– Bonjour Mizler !
– Bonjour, Maître, je suis en voyage et je suis passé par ici : je viens d’Erfurt où j’ai fait ma médecine je vais à Varsovie où je compte m’établir.
– Mais ce n’est pas du tout le chemin !
– J’ai fait un petit détour spécialement pour vous voir. Comment vous portez vous après votre voyage à Berlin ?
– Mais très bien, voyons. Vous voyez, je suis en train de travailler sur une des fugues dont le thème m’a été donné par le roi de Prusse.
– Puis-je regarder, Maître ?
– Mais bien sûr ! Je vais faire graver cela sur cuivre pour le faire imprimer… Mais Mizler, euh… puisque vous êtes médecin je voudrais avoir votre avis. Voilà : pour voir de près, j’utilise des loupes et des verres de plus en plus gros, et puis j’ai souvent l’impression de voir à travers un vitrail ou une sorte de brume. Est-ce que vous croyez que c’est, comme on me dit parfois, parce que, depuis que je suis tout jeune, je travaille si souvent et si intensément sur mes partitions ?
– Mais pas le moins du monde. Simplement, vous n’avez plus vingt ans.
– Savez-vous que j’ai dépassé les soixante ans ?
– Vous ne les paraissez pas, Maître.
– Avec une perruque, vous savez, on cache bien des choses. Oh ! cela ne m’empêche pas de travailler mais il me faut de plus en plus de chandelles pour m’éclairer et cela coûte cher la lumière, vous savez, Mizler. Ah ! Autre chose, vous qui parcourez le monde, venez, approchez-vous : voilà, je voudrais acheter une action dans une mine à Voigtberg, vous croyez que c’est bon ?
– Je pourrai me renseigner si vous le souhaitez.
– N’oubliez pas, hein ? Et votre société de savants, qu’est-ce qu’elle devient ?
– Elle attend que vous en deveniez membre, Maître.
– Oui, je sais mais j’hésite toujours. Regardez là j’ai même fait faire ce portrait de moi par Haussmann… au cas où je me décide.
Je pris le teableau et le posai de façon à ce qu’il soit bien éclairé.
- Vous voyez la feuille que je tiens à la main sur le tableau : c’est un canon.
Ce sera ma première contribution à votre société…si j’y entre. Maintenant regardez ce papier : c’est celui que je tiens à la main sur le tableau d’Hausmann. Venez, vous allez être le premier…
Je me mis devant le clavicorde :
– Écoutez…
Je lui jouai le canon… On pouvait superposer les voix jusqu’à 6 fois, en les décalant à chaque fois de quelques notes.
– Maintenant je mets le papier dans l’autre sens, le haut en bas. Tenez, jouez vous-même !
Étonné, il se mit à jouer :
– Cela sonne autrement mais c’est bien agréable aussi.
– Maintenant Mizler, je mets le papier devant la fenêtre, je le retourne, vous voyez par transparence ?
– Oui !
– Eh bien, jouez maintenant.
– Mais c’est incroyable, Maître et en plus cela sonne encore bien !
– Merci pour le compliment Mizler ! Moi voyez-vous, ce que j’aime dans celui-là, c’est qu’il se transforme presque en bruit, on est à la limite entre la musique et le bruit. Plus tard, peut-être fera t’on du bruit au lieu de faire de la musique !… Euh… Ah oui ! Combien faut-il payer pour être membre de votre société ?
– Environ 1 000 F par an. Vous seriez le 14ème (14 c’est votre chiffre), tout de suite après Haendel et Graun qui se sont inscrit !
– Haendel ? Et Graun aussi ? mais je l’ai vu à Berlin, il ne m’en a pas parlé. Telemann en est aussi, je crois.
– Oui.
– Il n’y a pas de réunions ?
– Non, ce sont des envois de documents, c’est cela qui coûte cher ! Il s’agit d’inscrire la musique dans le grand mouvement actuel des connaissances humaines.
– Eh bien, vous ne manquez pas de prétention ! Expliquez-moi alors comment il se fait que la nouvelle musique n’ait rien de scientifique comme vous dites. Moi, avec mes canons et mes fugues, j’ai l’impression d’être beaucoup plus scientifique que mes fils, par exemple.
– Mais justement, Maître, cette mode ne peut être que momentanée. Moi, je pense qu’il faut maintenir la musique au carrefour des Sciences et de la Beauté.
– Oui, mais moi, je n’écris pas de mots, comme tous vos membres. Et puis ce ne sont pas les sciences elles-mêmes qui m’intéressent, c’est la façon dont elles peuvent contribuer à me faire faire de la belle musique ! J’écris de la musique, pas des mathématiques ou de la philosophie, vous comprenez cela ?
– Telemann et Haendel font de même.
– Eh bien Mizler, Vous m’avez convaincu : je vous annonce que je suis des vôtres !
Le brave Mizler était tout heureux !
– Et vous aurez droit à une histoire de votre vie à votre mort…
Il devint tout rouge et je lui souris en lui prenant doucement le bras. Puis il redevint sérieux.
– Maître vous avez un devoir envers notre société et envers vous-même : faites en sorte que vos œuvres puissent rester. Faites les graver sur cuivre par exemple. Je le dis à tous nos membres compositeurs mais particulièrement à vous.
La discussion se poursuivit longtemps sur les sciences, la musique, les mérites des auteurs latins…
Je travaillai si intensément sur ce que j’appelais le Thème du roi (celui de l’Offrande musicale) qu’Anne s’en inquiétait.
– Tu ne t’arrêteras donc jamais. Fais donc attention à tes yeux.
– Je ne vois pas pourquoi travailler m’abîmerait les yeux ?
– Pourquoi ne pas me dicter ce que tu as en tête plutôt que de l’écrire ?
– Mais non, petite maman, je te le dirais si j’en ai besoin, comme je le fais toujours.
Et, après à peine deux mois, j’avais fini mon Offrande Musicale: début Juillet 1747, je la faisais parvenir au Roi de Prusse avec une belle dédicace en allemand. Je n'avais personne pour l'écrire en français, comme celle des 6 concerts pour la margrave de Brandebourg: d'ailleurs je n'en avais pas tellement envie.
Chaque jour, désormais, je travaillais à ma grande messe : ses proportions, sa construction, m’apparaissaient clairement. Je prendrais le temps de construire une cathédrale, comme disait mon cousin « panier percé ». Je cherchais dans mon œuvre passée les matériaux nécessaires à cette construction.
Mes fonctions de directeur de la musique de Leipzig m’occupaient toujours beaucoup. Görner et moi étions maintenant au mieux depuis que nous supervisions ensemble la réparation de l’orgue de l’église de Saint Thomas.
Mes deux derniers fils étaient presque de jeunes hommes. Frédéric avait déjà 16 ans. Il était toujours aussi bon virtuose et toujours aussi sage. Son jeune frère Jean-Chrétien était plus turbulent, mais rien à voir avec son défunt demi-frère Bernard. Il serait toujours comme un oiseau sur la branche, une vraie tête de linotte. Cela se ressentait dans son jeu.
Un exemple entre autres : il m’arrivait maintenant de me coucher plus tôt, avant que mes grands enfants ne s’endorment. Je leur demandai alors de me jouer du clavecin. Un jour Jean-Chrétien, croyant que je dormais, s’arrêta au milieu d’une improvisation sans finir un accord. Je bondis de mon lit et lui flanquais une de ces gifles dont j’avais le secret et terminai le morceau moi-même pendant qu’il se mettait à pleurnicher. Mais j’aimais bien ce petit garçon, il avait souvent les mêmes mimiques qu’Anne et cela me ravissait: après tout, il était mon petit dernier. Je lui promis un jour en plaisantant qu’à ma mort, il aurait mes clavecins.
Anne éprouva un grand bonheur quand elle apprit qu’Emmanuel lui demandait d’être marraine de mon deuxième petit fils. Elle qui avait toujours craint de ne pas être à la hauteur de sa tâche de mère pour soigner mes enfants de ma première femme, en éprouva un grand réconfort.
Un autre bonheur nous arriva, à moi et à Anne, bonheur que nous pressentions depuis quelque temps. Nous nous plaisions à observer les regards que se jetaient parfois notre fille Liesgen, et mon élève Altnickol, qui depuis quelque temps était payé en tant que choriste (voix de basse) à Saint Thomas. Ils nous annoncèrent un jour leur intention de partager leur vie, en respectant bien toutes les formes de la bienséance et de la religion. J’obtins d’ailleurs pour Altnickol quelques mois plus tard le poste d’organiste de ce splendide orgue de Naumberg que j’avais expertisé avec Silbermann.
Après l'Offrande, je pouvais maintenant reprendre le cours de mon travail : finalement cette société Mizler tombait bien, j’allais chaque année devoir produire pour elle une œuvre nouvelle. J’avais l’impression d’être revenu aux premiers temps de Leipzig, quand je faisais chaque semaine une musique nouvelle !
Chaque jour, je travaillais à ma grand messe.
Les chœurs et les airs s’y succédaient : certains étaient des œuvres anciennes et d’autres étaient totalement nouvelles. Je pensais ainsi que ma messe était comme une cathédrale qui se construit aussi bien avec des pierres neuves qu’avec des pierres anciennes. Je relus beaucoup des musiciens comme Palestrina, Pergolèse ou Lotti où je trouvai des idées bouleversantes. J’étais saisi moi-même de la beauté de ce que le Seigneur m’inspirait.
Je feuilletai souvent mes anciennes partitions. Il me vint à l’idée de reprendre mes six sonates pour orgue et je me mis aussi à retoucher des chorals que j’avais composé à Weimar. Contrairement à ma musique de chambre, j’avais conservé toutes mes œuvres pour orgue et mes musiques d’église… Parmi les chorals composés à Weimar, j’en retins une quinzaine. J’y apportai de légères modifications.
Après plus de 30 ans, j’étais heureux de constater que je restais fidèle à mon inspiration première…
Je m’aperçus toutefois que les voix qui accompagnaient ces chorals n’étaient pratiquement jamais des canons parfaits. Je décidai donc de prendre un thème de choral de Noël et de construire au-dessus de ce thème des canons parfaits : démonstration que la qualité technique n’est pas incompatible avec la profondeur de l’œuvre mais au contraire la rend plus riche et plus belle. Cela serait un apport utile à la société de Mizler. J’éprouvais en composant ces canons un sentiment de joie et de satisfaction. Je trouvais des solutions agréables à l’oreille à ce qui paraissait déjà un tour de force technique aux meilleurs musiciens.
Il paraît que les mathématiciens éprouvent les mêmes sentiments quand ils trouvent des solutions qu’ils apellent « élégantes ». Il faut donc croire que j’ai aussi un esprit mathématique.
Cependant, chaque jour ma grand messe se construisait. J’aimais bien avoir à l’esprit cette image des pierres neuves et anciennes.
Les pierres neuves étaient certains airs et certains chœurs, en particulier dans le Credo. Pour ce Credo, j’avais choisi de prendre le texte du symbole de Nicée, la prière universelle de tous les Chrétiens.
Les pierres anciennes, je les reprenais dans des musiques déjà composées : ainsi le Kyrie et le Gloria offerts au Prince de Dresde. Pour les autres parties, je choisissais mes « pierres anciennes » parmi mes musiques d’église qui me menaient le plus près de mon Sauveur. Je les modifiais parfois pour les adapter aux textes de la messe.
L’édifice allait former un tout, se dresser vers le ciel comme la cathédrale de Lübeck. Qui se préoccupe de la date de la construction de telle ou telle partie d’une église, si elle est belle et si elle vous mène vers le Seigneur ?
Pour le reste, je n’en dirai pas plus : écoutez simplement ces musiques… seule la musique pourra pénétrer votre âme de cette façon.
J’avais aussi en tête mon cahier d’exercice de contrepoint et de fugues. Autour de moi on appelait déjà l’Art de la Fugue. Ce titre était faux car je voulais y mettre aussi, tout comme dans mes cahiers précédents, des canons ou autres formes de contrepoint. Finalement j’avais prévu que ce cahier comprendrait 24 pièces, les premières ayant déjà été composées depuis 7 ou 8 ans déjà. Je les avais mises dans un ordre qui tenait compte de leur rapport entre elles et de leur complexité croissante. Je travaillais avec Schübler pour les faire graver sur cuivre. Déjà j’avais les dernières pièces en tête et je les avais même recopiées sur le papier sous forme de brouillons sur deux portées : je me souviens justement de l’un de ces brouillons que je n’avais pas pu finir car ma plume à cinq becs m’avait échappé des doigts, rendant les portées inutilisables. C’était le brouillon d’une fugue avec les quatre notes B A C H (si bémol, la, do, si) comme troisième thème, ajoutant ainsi un nouveau symbole à découvrir par ceux, s’ils devaient un jour exister, qui aimeraient retrouver des symboles dans ma musique.
Je travaillais toujours à bâtir ma grande messe.
Je devais bien constater que le voile devant mes yeux s’épaississait et ne me facilitait pas le travail. Notre maman avait du mal à cacher sa peine et son inquiétude devant l’état de ma vue: elle avait près de 50 ans maintenant. Heureusement, pour m’aider, j’avais près de moi des amis fidèles : mon cher copiste Vr prenait beaucoup sous ma dictée et continue à le faire aujourd’hui encore. Mon futur gendre m’aidait aussi avec une constante gentillesse. Catherine, ma fille aînée, était toujours aussi gaie et vaillante. Je pouvais donc continuer à travailler presque normalement.
Je dois dire aussi que les gens de l’extérieur qui faisaient les choses mal ou incomplètement avaient de plus en plus le don de m’horripiler.
Ainsi un aubergiste qui tardait à me rendre un clavecin eut droit à une lettre plutôt salée.
Il en fut de même pour ce brave cousin Jean-Elias qui en son temps avait éduqué certains de mes enfants. Il m’écrivit une lettre ampoulée pour me demander un exemplaire d’une partie de mon Offrande Musicale et je lui répondis :
"Le temps me manquant je vous dirai beaucoup de choses en peu de mots…au sujet de l’exemplaire…que vous me réclamez, je ne puis vous donner satisfaction… car l’édition s’en trouve justement aujourd’hui épuisée…(seulement cent exemplaires ont été imprimés dont la plupart ont été offerts gratis à de bons amis). J’en ferai tirer quelques autres d’ici à la Foire de la nouvelle année; si monsieur le cousin a encore l’intention d’en avoir un exemplaire… il lui suffira de m’en faire part à l’occasion et de m’envoye un thaler (500 F) et ce qui est réclamé arrivera.."
Le pauvre garçon m’envoya aussi un jour un tonneau de cidre qui m’arriva aux trois quarts vide. Je lui répondis, en novembre 1748 par une lettre que, pour une fois, j’écrivis moi-même..
"Il est extrêmement regrettable que ce petit fut ait souffert soit à cause des cahots de la route soit pour toute autre raison".
Et en post scriptum, j’ajoutais
"Bien que mon cousin se soit offert à envoyer de la même liqueur… il faut l’en dissuader… chaque mesure me revient à 5 groschen (100 F) ce qui pour un cadeau est bien trop cher".
Je lui fis également comprendre dans la même lettre que je ne souhaitais pas trop qu’il vienne au mariage de ma fille
"L’éloignement aussi bien que la mauvaise saison ne permettront sûrement pas de voir chez nous monsieur le Cousin en personne".
Le mariage de « Liesgen » (Elizabeth) avec mon élève Altnickol eut lieu le 20 Janvier 1749. Ce fut une fête merveilleuse. Les jeunes époux étaient radieux : elle avait 23 ans et lui 29. Guillaume et Emmanuel avaient pu venir ainsi que des membres du conseil municipal de Naumburg, et de nombreux amis de Leipzig et de Dresde. Notre maison était bondée et nous avions dû empiéter sur l’école pour réunir tout le monde à l’intérieur car il faisait très froid. Mais le plus beau cadeau, c’est peut-être moi qui le reçus en écoutant ma femme, mes enfants, nos amis, et moi-même bien sûr aussi, faire tous ensemble une orgie de musique. Quel autre art pourrait donner autant de joie à la fois à ceux qui le pratiquent ensemble et à ceux qui l’entendent ensemble ? N’avais-je pas négligé ces derniers temps cet aspect de mon art ?
Non, puisque chaque jour je continuais à bâtir ma grand messe.
À la fin de ces noces, je ressentis quelques vertiges et une sorte d’oppression dans la poitrine que je n’avais jamais connus auparavant. Anne s’en alarma et me supplia de me reposer : je ne pouvais rien contre elle quand elle prenait ce sourire inquiet et suppliant. Je m’endormis… Je fus réveillé au milieu d’un rêve où m’apparaissait Anna Amalia : elle avait l’air d’un ange et me parlait de ma messe en chantant.
Je sortis peu à peu de ma torpeur : en réalité c’était Anne qui chantait doucement en s’accompagnant au clavicorde. Ce réveil se fit dans un doux apaisement. Cet air que chantait Anne serait une nouvelle pierre pour ma grand messe.
Jusqu’à cette page j’ai tenu à rédiger moi-même les textes qui précèdent. N’étant pas particulièrement doué pour les mots, je tiens à faire part à mes lecteurs de mon regret d’avoir si mal écrit et si mal raconté. Mais j’ai pour moi la sincérité.
Ma vue baissant, je préfère garder mes capacités d’écriture pour la musique.
Les textes qui suivent seront donc dictés, en particulier à Vr, à mon épouse Anne, à mes fils, à mon élève Müthel et à d’autres. Il est bien probable que je ne pourrai pas les relire.





